![]() |
| La cueillette des cerises, Emile Vernon |
Chapitre dix-septième
Dix mois auparavant, les premières froidures et gelées du matin envahissaient les pelouses abandonnées de Moesta et Errabunda. Le parc s’embrumait d’une ambiance sinistre, fantomatique, propre à voir surgir quelques spectres de remords torpides en un ruissellement de créatures de marécages. Les feuilles mortes pourpres, prunes ou ocres voletaient çà et là sous les vents contraires de l’automne, s’agglutinaient dans les ornières où elles formaient des tas pourrissants d’un humus stérile, quelquefois capturées sous une couche de glace que les rayons de plus en plus timides de Phébus peinaient à effacer. A la belle aube, dans l’herbe prise par le givre blanc, le sol crissait sous les bottines des fillettes qui osaient encore une sortie matinale. Même la Marne commençait son embâcle, son onde calme emprisonnée dans une pellicule adamantine et opaline scintillante au soleil levant, glaçure allant s’épaississant de semaine en semaine, qui piégeait les nymphéas moribonds et les dépouilles caduques des feuillus chues en ce lieu. Parfois y venaient des restes desséchés de folioles et de sépales arrachés des prés folasse, des débris de lysimaques, d’asphodèles et d’ajoncs achevant leur processus de décomposition. Les ramures des chênaies terminaient de se dépouiller sous les assauts tempétueux qui dégageaient le ciel, après que se furent succédé de longs jours de pluies glaciales vous trempant jusqu’aux os. Les roseraies se métamorphosaient en simples roncières où finissait de s’étioler l’ultime fleur pâle et tardive, maladive de l’automne, en une lente chute de pétales séchés. Les corbeaux se regroupaient et croassaient, messagers d’un hiver n’annonçant rien de bon. Les efflorescences et fragrances de la végétation brûlée envahissaient tout le terrain, s’insinuant jusque dans les pavillons de l’Institution, tenaces, irritantes, mortifères. Il ne fut lors plus question que les enfants s’aventurassent dehors avant la mi-journée en robes légères aux dessous de mousseline et de faille. Il fallait qu’elles s’adaptassent au général Hiver. L’augmentation conséquente du nombre des pensionnaires provoquait une flambée des dépenses vestimentaires et nutritives. Cela fit la fortune de Madame Grémond qui devint la fournisseuse en linge de Moesta et Errabunda, un linge réservé à d’étranges petites filles modèles, qui comprenait une corsetterie miniature aux tailles de sept à quatorze ans. Des dessous particuliers aussi, dont on se fût attendu à ce que des tenancières de maison de tolérance les commandassent, tant ils comportaient ouvertures, boutons et laçages suggestifs. Cela procura du travail à mainte gamine de filature, va-nu-pieds et sale de figure, comme l’avait été une certaine Adeline Cardioux, une châtain-blond anémique d’environ onze ans, que le révérend Dodgson magnifia et transforma en icône de l’esclavage ouvrier en la photographiant dans son tablier maculé de graisse devant ses fuseaux de coton, pauvresse devenue elle-même entre-temps pensionnaire de la Maison sous le nom de Sixtine. Il fallut donc préparer aux fillettes des toilettes pour l’hiver : pelisses, robes de laine, de mérinos, de mohair, de vigogne et de velours épais, manchons, ganterie fourrée, bottillons du même acabit, chapellerie, bas épais de lainage et lingerie de flanelle. Madame la vicomtesse de** et Cléore se partageaient les frais de ces fournitures, sans que nos industriels du textile et nos boutiques spécialisées de Paris en habits enfantins s’étonnassent outre mesure que celles-ci ne concernaient que des fillettes.
La Toussaint et le Jour des Morts s’étaient passés sans ferveur aucune pour une comtesse de Cresseville imperméable aux momeries catholiques. La Maison comptait désormais vingt-deux pensionnaires, en incluant la malheureuse Ursule Falconet, et la hiérarchie des couleurs des rubans, enfin arrêtée, put lors s’appliquer toute, sachant que seules Cléore et Délia avaient droit à la pourpre et au noir pour l’une et au fuchsia pour l’autre. Cela donnait aux petites l’allure de colonelles à la bavette. Les fillettes couchaient et se toilettaient alors dans un dortoir unique sauf Délia, Jeanne-Ysoline, Daphné et Phoebé, qui jà faisaient chambrée à part. A dix-huit pipelettes, les choses devenaient ingérables, d’autant plus que les gamines, au lieu de se vêtir ou de se laver seules, chacune dans son tub, ou à son lavabo, voulaient tout faire en groupe afin de s’amuser bellement. C’étaient d’interminables séances de déshabillage ou d’habillage collectif, de barbotage à plusieurs dans des baquets ou des baignoires-sabots à la Marat, de piailleries jactantes, d’assourdissants jabotages de basse-cour où Sarah ne parvenait plus à maintenir l’ordre. Les petites catins déchaînées laçaient et délaçaient sans cesse leurs corsets à trois-quatre dessus, enfilaient bas, pantaloons et jarretières les unes aux autres en riotant de joie. Elles se tâtaient, s’attouchaient, s’exploraient toutes, découvrant mutuellement les secrets de leurs jeunes corps, s’amusant par de troublants jeux avec les fentes des bloomers, appliquant entre elles en d’hardis exercices de caresses tactiles les cours que Délia leur prodiguait pour qu’elles en usassent en principe avec les clientes. Le dortoir se métamorphosa conséquemment, à la grande terreur de Cléore et consort, en coruscantes parties fines et d’écarté entre dix-huit poupées qui expérimentaient des formes juvéniles et cénobites de plaisir. Au petit jour, le dortoir musquait tellement du fait de ces pratiques que Sarah s’obligeait à l’aérer toute la matinée. Quitterie, qui jouait aussi, mais plus discrètement, plus innocemment, avec ses poupées, et se contentait d’une seule partenaire de chair, attrapa à ces occasions une bronchite.
Vers la Saint-Martin, Quitterie fut alors si malade qu’on craignit pour sa vie. Elle crachait le sang et dégouttait d’une fièvre malsaine. Il n’était pas question qu’un médecin vînt. Nous rappelons qu’une infirmerie avait été installée dans un des pavillons dès le début, et que Madame la vicomtesse avait recruté deux infirmières d’une dévotion et d’une fidélité à toute épreuve – deux anandrynes bien sûr, dont elle avait contrôlé les qualifications – lesbiennes d’hôpitaux qui sauraient se taire car mieux payées qu’à l’ordinaire. L’une, Diane Regnault, était une sœur défroquée à cause de ses penchants et l’autre, Marie Béroult, une des amantes – et le médecin-femme à titre privé – de Louise B**. Leur dévouement et la cure adéquate, avec les remèdes efficaces et nouveaux venus de la médecine anglaise permirent de guérir Quitterie, qui toutefois demeura convalescente encore cinq semaines. Elle manqua lors la visite d’un hôte de marque : le grand photographe, mathématicien révérend et écrivain anglais Charles Dodgson, lors âgé de cinquante-sept ans. Cléore elle-même ressentait une lassitude certaine ; elle aussi souillait ses mouchoirs de sérosités sanguinolentes. De plus, en ses entrailles fermentaient les résultats des tourments que toutes ces tribades avaient infligés à Poils de Carotte.
Répondant à l’invitation de la comtesse de Cresseville, Charles Dodgson arriva en l’Institution le lendemain de la Saint-Martin. Il se présenta en grand arroi, encombré de tout un appareillage photographique et chimique, d’une bibliothèque ambulante composée d’œuvres majeures de George Eliot, Benjamin Disraeli, Alfred Lord Tennyson, Anthony Trollope, Elizabeth Gaskell, Wordsworth, Carlyle, Coleridge, Byron, Swinburne, Elizabeth Browning, Dickens, Keats, Shelley et lui-même sous son nom de plume, sans compter une théorie d’étranges jouets plus intrigants les uns que les autres. Il s’insinua comme un pique-assiette, séjournant trois longues semaines à Moesta et Errabunda, au détriment de ces Dames qui se plaignirent avec amertume de sa présence envahissante. Il perturba même le bourreau de Béthune.
Alors que la comtesse de Cresseville s’était attendue à ce qu’il jetât son dévolu sur Adelia, du fait que tous deux partageaient une langue maternelle et une culture communes, Dodgson préféra les jumelles, à cause de leur trompeuse pureté enfantine. Le doux, céruléen et grave regard languide attendrissant de Daphné et Phoebé le fascinait. Elles étaient blêmes comme des lys et il les croyait vierges. Il faut dire qu’elles incarnaient un idéal de beauté préraphaélite. La leukémia chronique dont elles souffraient ajoutée à leur presque albinisme les enjolivaient tant qu’elles en étaient devenues le symbole même de la diaphanéité blonde incarnée. Dodgson se les figurait jà dans une nudité idéalisée d’innocence, sans même se douter qu’elles touchaient à l’âge pré-pubertaire. D’après le révérend, leur gémellité sororale constituait à elle seule une énigme mathématique et zoonomique digne de Gauss et d’Erasmus Darwin, tout comme le mystère sanguin de leur maladie de langueur, la soie immanente de leurs longues english curls d’un blond nordique et leur silhouette d’elfes d’une évanescence rare. Il saisit leur unicité gémellaire, leur aspect de Dioscures femelles, peut-être issus de quelque énigmatique parthénogenèse mariale, lui qui n’était pas papiste. Il prenait souventes fois un breakfast anglais en leur suave compagnie, les bourrant à ces occasions de plum-puddings, de plum-cakes, de bacon, de pancakes et de muffins afin qu’elles se remplumassent. Tout en se réjouissant du rosé de leurs joues et du mignon tablier enfilé sur leurs robes blanches qui lui rappelait sa chère Alice telle que Sir John Tenniel l’avait croquée, il poursuivait la manducation matutinale en leur proposant en supplément œufs brouillés ou mollets, sirop d’érable, pâtes de coing et tartines dégouttant et transsudant de miel, de confiture de rhubarbe ou de marmelade d’orange. Les lèvres et les joues maculées, barbouillées, moites et luisantes de toutes ces gourmandises nutritives, Daphné et Phoebé, qui, comme l’on sait, n’appréciaient que les sucreries et le sang, écoutaient lors religieusement le révérend orienter la causette vers des sujets plus philosophiques, vers un tour plus socratique en des dialogues gnostiques, où maïeutique, propédeutique, synecdoques et accolages de mots les ébaudissaient et les distrayaient du fait de la virtuosité de ces figures de style. Studieuses et séduites par les manières et le savoir de ce vieux garçon timide au visage encore étonnamment jeune, porté sur les amies-enfants, elles le questionnaient avec une niaiserie d’oies blanches médiévales, multipliant les naïvetés de lais féeriques du style « Mon révérend, pourriez-vous nous dire s’il est vrai que la Lune, notre Séléné, est suspendue au ciel par des fils de soie ? »
Pourtant, alors qu’elles faisaient de leur côté des efforts nonpareils pour s’exprimer en alternance dans les deux langues, anglaise et française, sans jamais bafouiller mais toutefois en grasseyant et en blésant, Daphné et Phoebé éprouvaient une gêne sincère face aux laborieux verbiages de bègue du révérend écrivain.
« Je…je vais vous prop… popr… vous montrer ma valise de …d’énigmes…
- Une valise qui contiendrait des attrapes…
-… et des farces pour nigaudes ? s’interrogeaient-elles, l’une débutant la phrase, l’autre l’achevant, parfois dans une langue divergente.
- Non…non…pas ce…cela.
- Sont-ce de savoureux bonbons au poivre, ou quelques chocolats aux aulx que vous allez nous proposer, telles ces friandises du démon que Délie nous offrit pour notre anniversaire voilà tantôt dix jours ? Nous avons jà treize ans !
-Je…admi…rez et…vo…voy…ez, misses. Ou plutôt you…young la…dies. »
Dodgson exhiba d’une mallette de cuir plusieurs casse-tête, objets mathématiques, dont des sphères armillaires képlériennes dont l’emboîtement les fascina. Ce fut surtout ce baguenaudier chinois, ce jeu aux neuf anneaux, qui les passionna le plus. Elles entrevirent quel beau parti jouissif elles pourraient tirer de ce jouet quoiqu’elles en usassent de bien d’autres tout aussi coruscants lors de leurs jeux intimes. Naïf, le révérend croyait s’adresser à d’innocentes amies-enfants. Afin qu’il les dorlotât, Daphné et Phoebé feignaient une mine triste, ouvraient comme des fanaux leurs grands yeux suppliants et mélancoliques, faisaient semblant l’une de se plaindre d’un bobo au petit doigt en y nouant un morceau de mouchoir, l’autre d’avoir mal à la gorge en toussotant sans cesse et en s’exprimant d’une petite voix flûtée quémandant des guimauves. Dodgson, dupe de ces pleurnicheries, les cajolait lors, les embrassait, consolait leurs petits chagrins de poupées qui n’étaient que feintises, en appliquant sur elles un consolamentum, une accolade presque cathare.
Le trio se revit chaque jour, jusqu’à ce qu’il vînt l’envie à Charles Dodgson d’immortaliser ces deux petites merveilles sur plaque photographique. Il en informa Cléore et Sarah, leur expliquant qu’il souhaitait que Daphné et Phoebé posassent ensemble pour des tableaux vivants à l’antique. Il s’inspirerait, expliqua-t-il, des peintres situés entre les Carrache, le Dominiquin et Salvator Rosa mais également de peintres anglais contemporains. Il exposa, en un symposium digne d’une apologie de l’Aesthetic movement auquel Cléore adhérait, en quoi consistait l’art de Julia Margaret Cameron, disant, qu’à la manière de cette dernière, il jouerait de l’évanescence pellucide naturelle des jumelles afin que ses clichés apparussent floutés, impressionnistes, pictorialistes et sépia et que l’on perçût seulement les linéaments des êtres irréels dont l’image était fixée. Il ordonna à la valetaille en perruque qu’elle fît de la place dans le grand salon d’honneur, en poussant meubles, sofas, harpe et piano. Ce n’était pas la première fois que Daphné et Phoebé se prêtaient au petit jeu perturbant et connoté de l’art photographique. Elles avaient posé pour une anandryne voici déjà deux mois, leurs corps nus simplement emmitouflés de pelleteries de zibeline et d’hermine, dans des postures d’une lascivité telle que ces épreuves ne purent circuler que sous le manteau parmi de fort spéciaux collectionneurs amateurs de fruits verts.
Lorsque Sarah, Zorobabel sur l’épaule, vint chercher les jumelles dans leur chambrette qui servait aussi de boudoir spécial, elle les surprit dansant enlacées, sur la musique nasillarde et lente d’un phonographe à cylindre Edison où l’on reconnaissait vaguement le prélude de Lohengrin, toutes soupirantes, le regard embué de larmes, frottant leurs petits nez l’un contre l’autre, revêtues de leurs plus jolis atours de mousseline et de batiste, affichant avec ostentation leurs nœuds bleu-nattier, sachant qu’elles seraient les premières à parvenir au nouveau grade de chamois, promotion promise par Cléore avant la prochaine Saint-Valentin. Sarah interrompit leur étreinte langoureuse d’amoureuses transies. Elle réprouvait ces amitiés étranges, saphiques certes, mais surtout incestueuses, contre nature. En grommelant, sous les sarcasmes du rosalbin qui ne cessait de coqueter, Daphné et Phoebé s’allèrent lors au salon où le révérend avait jà déplié le pied de son appareil et commençait à installer la chambre noire à soufflet. Sarah désigna le paravent de soie chinois au motif de grues cendrées, leur demandant qu’elles se missent en tenue antique pour poser. La vieille juive ordonna ensuite aux larbins qu’ils jetassent plus de bûches dans la cheminée afin que nos petites n’eussent point froid en nu gréco-romain. La manière dont les jumelles interprétèrent cet ordre ne correspondit pas tout à fait à ce qu’en attendait Dodgson : elles étalèrent ce qu’elles entendaient par nudité antique ; c'est-à-dire qu’elles s’affichèrent certes torse nu, mais en pantalons de dessous érotiques, d’une provocation et d’une impudicité inouïes. Cette lingerie apparaissait si ajourée et fendue qu’elle ne cachait point grand’chose de leur anatomie. Dodgson s’en troubla. Il constata que leurs dos se zébraient de cicatrices de flagellation, sport qu’elles pratiquaient à deux ou en compagnie d’Adelia. De plus, si leur peau translucide de vraies blondes était d’une troublante diaphanéité quasi fœtale et intra-utérine, elle exhalait cependant des fragrances brûlantes, musquées, ambrées, fortement aphrodisiaques. Il faut dire que les torses de Daphné et Phoebé paraissaient luire d’une onction d’huile à caractère lustral. Elles aimaient à humecter leurs poitrines naissantes, leur ventre, leur dos et leurs fesses de parfums anciens, d’une extrême vieillesse, épaissis par l’âge, poivrés par leur décomposition, tournés, rancis, huileux et bien violents, propres à enflammer leur désir mutuel, parfums de peau d’Espagne putrescents qui piquaient leurs narines de leur arôme vieillot, comme si on les eût soutirés sous la forme d’un suc résiduel d’un balsamaire, d’un aryballe et d’une pyxide de Halos, d’Herculanum ou de Paestum. A ces humections rituelles capiteuses et épaisses dignes de Bilitis, de Lesbia, de Poppée ou d’Ovide, elles joignaient une cire épilatoire qui les débarrassait du duvet blondin de leurs bras et de leurs jambes, tout en conservant l’essentiel intime naissant. Puis, elles ajoutaient de lents massages de beurre salé suri, qu’elles épandaient sur le dos, le cou, la nuque, l’abdomen, l’entrecuisse et le postérieur, beurre rance auquel elles additionnaient un condiment africain : le karité. Ainsi oints, leurs épidermes aromatisés embaumaient de fragrances vénériennes d’une telle blettissure que les domestiques ci-présents en ce salon avaient grand mal à se retenir de débecter, comme s’ils avaient humé quelque camembert fort antique qui eût servi de mètre-étalon de la puanteur. Les échanges chimiques que tous ces composés engendraient finissaient par produire une admixtion magique d’où émergeait une substance opiacée, sirop ou julep corporels d’un genre nouveau, substance qui abrutissait les fillettes de son prégnant fumet aphrodisiaque huileux. C’était un effluve fauve, un musc primitif, antédiluvien, de l’origine préhistorique de la sexualité humaine.
Écœuré, Dodgson ne pouvait qu’être dérangé par les usages singuliers de ces fausses incarnations de l’innocence blonde. Il avait entendu par ouï-dire que, chez les sauvages, plus la femme puait, plus elle attirait le mâle. Il savait qu’en botanique existaient des plantes carnivores qui piégeaient les insectes en exhalant des arômes de bananes pourries. Pour lui, tout allait trop loin dans l’inconvenance. Il harcela Cléore de questionnements au sujet des bloomers de créatures, sans faire cas de la vêture pourtant explicite de Lady de Cresseville, adonisée qu’elle était en femme-enfant modèle aux anglaises carotte, enrubannée de ses faveurs de soie pourpres et noires qui la désignaient clairement, sans équivoque, comme la mère maquerelle de ce duo de jumelles-catins. Pour l’immortel auteur des pérégrinations féeriques d’Alice, la vêture de Daphné et Phoebé (sans parler de leur parfum), équivalait à aller nues comme un saint Jean. Il s’en offusqua :
« La…Lady de Cre…Cresse…Cresseville. Ces…ces pan…pantaloons sont bien…im…pudiques et in…convenants. »
Dans la prude bouche victorienne de l’ami et créateur d’Alice, c’était là critique bien affûtée. Cependant, l’élément obscène de la lingerie des deux inséparables gaupes miniatures, qui dévoilaient sans retenue leur douce peau nymphéenne apogonotonique1, n’était pas le seul composant turbide qui pût choquer notre puritain, en plus des humections chancies et des traces dorsales de coups de fouet : ce linge reprisé suait en lui-même une saleté subtile, souffrait jusqu’à la trame cotonnée des traces d’une perspiration de diaphorèse, d’une transsudation intime, en cela qu’y persistaient d’indéfinissables marbrures aux parties ajourées de l’étoffe. C’était jauni, croûteux, immonde d’une sanie séchée mêlée à un je-ne-sais-quoi d’écoulements. Dodgson se contraignit à harceler Cléore à ce sujet ; il tempêta :
« Êtes-vous bien certaine, my lady, de…de me garantir l’hygiène soi-disant irréprochable de vos deux petites pensionnaires ? Je perçois en cette lingerie maintes traces, survivances discrètes, certes, mais qui per…persistent, d’un quelque chose que je qualifierais de…de cho…quant et d’impu…dent. Me garantissez-vous, Lady Cléore, que Daphné et Phoebé, baronnes de Tourreil de Valpinçon, se changent tous…tous les jours ainsi que nous l’imposent nos modernes hygiénistes ? Déjà que leur peau, enduite de ces soûlants parfums rances, m’incommode fort…
- Elles changent effectivement leurs chemises et bloomers chaque jour.
- Mais alors, ces traces de…saleté, sont…sont-ce ? …J’a…j’avais de…demandé…que vos…vos jumelles, en sous-entendu, certes, se drapassent à la grecque…co…comme la Vénus de Milo ou la…Victoire de Samothrace…, non point qu’elles…missent ces hideux pantaloons souillés et ouverts de … partout. Ils sont…çà et là jau…jaunis…On croirait qu’elles ont subi quelque…épanchement d’incontinence…d’un organe é…émonctoire2. »
La comtesse de Cresseville refusa de répondre. Elle ne pouvait décemment dévoiler la vérité au révérend, cette vérité qu’entreverra Jeanne-Ysoline l’année suivante. Daphné et Phoébé avaient beau renouveler leur linge, ce dernier avait beau subir des lessives répétées, il demeurait toujours des traces de leurs ébats d’affection sororale. Comprenant cependant le reste – fondé – de la critique de son éminent hôte, elle demanda à Sarah d’apporter deux petits draps propres d’une blancheur de vierge. Cléore avait veillé à ce que ces draps ne fussent ni empesés, ni apprêtés. Elle bannissait tous ces empois à base d’eau gommée. Il fallait à présent que les jumelles ôtassent leurs pantalons et ceignissent leurs reins de ces sortes de pagnes grecs ; qu’elles en fissent des draperies antiques. Elles prendraient lors l’aspect de statues marmoréennes de nymphes de Praxitèle et de Scopas et seraient prêtes pour chaque cliché. Il fallait que ces photographies sublimassent et magnifiassent ces deux fragiles enfants, qu’elles demeurassent pour l’éternité dans la mémoire des hommes, bien au-delà de leur trépas, icônes des plus jolies fillettes que le Créateur eût jamais engendrées. C’étaient comme des anges de Bouguereau et Julia Margaret Cameron, mais des anges ambigus, qui eussent pu devenir des change-sexe, tel ce prince Isolin devenu Isoline, en cet opéra-comique enchanteur dû aux talents conjugués de messieurs Catulle Mendès et Messager, lors donné l’an passé.
De fait, le révérend avait l’intention de ne prendre que trois photographies mettant en scène Daphné et Phoebé en des réinterprétations d’œuvres baroques ou modernes :
- Melpomène en Perséphone, de Lorenzo Lippi ;
- Peinture et Poësie, de Francesco Furini ;
- Le Tepidarium, d’Alma-Tadema.
Les peintures numéros une et trois, en principe, ne représentaient qu’un seul personnage du beau sexe : il s’agissait donc d’une traduction photographique radicale des sujets. Seules les allégories de l’œuvre seconde impliquaient d’évidence un duo féminin, mais son caractère revêtait une telle connotation saphique implicite que les plus grands exégètes et interprètes qui s’étaient succédé pour lui attribuer un sens caché n’y avaient tous vus qu’une apologie de l’amour entre femmes. De plus, Le Tepidarium, qui comptait parmi les plus récents chefs-d’œuvre de l’école d’Angleterre, apparaissait comme emblématique de ces Arts for art’s sake esthétisants que Cléore adorait. Enfin, au grand dam de la rigoriste Sarah, alors que Melpomène, notre immortelle muse de la tragédie, était correctement vêtue chez Lippi, il n’en allait pas de même dans le projet de Dodgson. Et l’ultime cliché impliquait que Daphné et Phoebé posassent dans le plus simple appareil d’Eve, alanguies lascivement chacune sur un sofa en vis-à-vis, avec un éventail de plumes d’autruche cléopâtrien en guise de cache-sexe ou de cache-misère, telles des allégories érotiques de la gémellité.
Il fut lors convenu que les gamines se positionneraient vers le fond de la pièce, là où la lumière pénétrait le moins, à proximité desdits sofas, lors poussés, ce qui nécessitait un éclairage artificiel de chandeliers et candélabres et l’utilisation par le photographe d’une espèce de poudre inflammable éclairante à base de magnésium qu’Outre-Manche on qualifie de flash. Les valets en livrée et perruque étalèrent des tapis de Perse décorés de fleurages, aux arabesques et guirlandes orientalisantes, perses sur lesquelles les jumelles allèrent placer leurs pieds nus poupins. Ils ajustèrent avec leurs mollettes, avant qu’elles fussent ignées, les mèches des bougeoirs portatifs à huile, dont le verre et le cul-de-lampe avaient été astiqués au tripoli. Ils vérifièrent le bon état des charmilles et corbeilles de cire, authentiques strelitzias, paulownias, rauwolfias et dahlias embaumés et conservés à jamais grâce à un procédé adapté des écorchés de Fragonard, qui comportait l’injection dans les vaisseaux des plantes de plusieurs solutions colorées cireuses. Les murs aux boiseries cinabres, quant à eux, s’ornaient de tapisseries représentant Sainte Cécile à la viole de gambe, d’après une peinture célèbre du Dominiquin, et l’histoire d’amour romanesque de Pyrame et Thisbé.
Les domestiques tendirent d’abord les draps comme des paravents. Derrière, nos deux petites coquines se débarrassèrent de leurs pantalons en gloussant comme deux maries-salopes fomentant un mauvais coup, sous-vêtements que leurs pieds repoussèrent avec négligence hors de leur champ comme on le fait du linge sale (ce qu’ils étaient pour Dodgson). Une fois leurs reins bien drapés, Sarah fit apporter des boîtes à fards et à kohol : on les maquilla, poudra leurs joues, passa du rouge d’Espagne sur leurs lèvres, rehaussa leurs sourcils au crayon, farda leurs paupières de bleu cobalt etc.
Ainsi apprêtées, s’étant disposées pour leur premier tableau vivant sans qu’elles sussent encore la pose exacte qu’elles devaient prendre et les accessoires qui devaient parfaire l’épreuve photographique, elles prirent avec justesse un regard vague, éteint, absent, extraordinaire de détachement, en fixant l’objectif de l’appareil de celui qui signait ses œuvres littéraires et iconographiques du nom de Lewis Carroll.
A la vue des deux jolies et faussement sérieuses enfants, fin préparées en nus mythologiques pour leur séance de poses suggestives, désormais presque aussi peinturlurées que des lorettes de bas étage, Charles Dodgson se troubla une deuxième fois. Ce fut Phoebé, la souffreteuse et vaporeuse Phoebé, qui alluma surtout la flamme de son plaisir. Elle était d’une gracilité inouïe, d’une grâce extraordinaire, surnaturelle, et quasiment divine. Son corps de frêle poupée blondine de treize ans exsudait une sensualité torride. Sa taille étranglée de meurt-de-faim luminifère, de petite nymphe éthérée des sous-bois et des sources, avivait particulièrement les sens du vieillissant révérend-mathématicien. Il faut dire que la petite maligne avait exprès ceint et noué son drap-pagne de biais et très bas, plus bas que sa ceinture pelvienne, ce qui permettait de deviner de face son provocant et duveteux triangle pubien tandis que de dos se révélait une partie non négligeable de ses petites fesses de dryade marquées de traces de sévices divers, de coups assenés par sa sœur lors de bien spéciales parties de plaisir sadiques, fesses tuméfiées, constellées de bleus violacés et de rougeurs malsaines, provoqués par ce que celui qui se faisait appeler Lewis Carroll supputait être soit une pelle à tarte, soit une trique de châtiments corporels à l’anglaise.
Ne voyez point, amies lectrices, dans cette passion naissante du savant-écrivain pour une nouvelle et fort mignonne amie-enfant, un quelconque outrage aux bonnes mœurs ou la perversité torve d’un satyre. Ces sortes d’amours pour de petites filles pré-pubères sont choses bien courantes dans notre Occident évolué. Pour ceux qui en ont assez de leur femme opulente et goitreuse, qui craignent que les créatures ne les vérolent, Daphné et Phoebé, avec leurs seins naissants et leur esquisse de toison pubienne, représenteraient une excitante alternative dont il serait de bon goût de s’extasier dans les salons fréquentés par la bonne société et les gens comme-il-faut.
Dans l’ensemble, avec leurs boucles torsadées de couleur paille dorée qui tombaient sur leurs épaules, sur leurs mamelons pointus jà aréolés et à la naissance de leur postérieur, Daphné et Phoebé étaient à la semblance de korês archaïques, de ces cariatides de temples grecs au sourire primitif. Elles incarnaient une version neuve du mythe de l’éternelle jouvence, tant enviée par la fleur qui passe et s’en va s’étioler. Plus tendres qu’un oison, plus melliflues qu’un nectar, plus ambiguës qu’un julep de Des Esseintes, telles se présentèrent devant la chambre noire Daphné et Phoebé baronnes de Tourreil de Valpinçon, idéaux gémellaires, en leur premier tableau vivant, Melpomène en Perséphone ou la Muse lugubre, d’après Lorenzo Lippi. Le principal accessoire de cette mise en scène consistait en un masque énigmatique, un faux-semblant d’identité dévoilant le vrai visage de la muse, l’autre élément allégorique étant la grenade éventrée.
Nous aimons à rappeler ici la symbolique de la grenade, fruit de la vie, de la fertilité, de la puissance, fruit de sang et de mort. La symbolique est tout autant chrétienne car la grenade représente l’Ecclesia, la Création dans la main de Dieu et Jésus-Christ lui-même.
Faute cependant de disposer de grenades authentiques, il fallut se contenter d’imitations. Par chance, les collections sulfureuses de bibelots de Moesta et Errabunda regorgeaient de faïences de toutes sortes, zoomorphes et plantiformes (c’est-à-dire végétales), volailles, hures et fruits factices de Sèvres, de Saxe ou de l’école d’Alsace, grappes de raisins, pampres, melons, pastèques, coloquintes, poireaux ou citrouilles. Deux sphères grenadines de l’atelier d’Hannong firent l’affaire.
Conformément à l’opus baroque de Lorenzo Lippi, notre couple de fleurs du mal pré-nubiles devait tenir la grenade en sa senestre main et le masque en la dextre, presque à portée de leur visage chérubin. Ce masque, comme s’il eût été conçu pour camoufler la défiguration d’une prostituée vitriolée, alimentant ainsi les fantasmes les plus crus du client, ne devait présenter aucun trait particulier, être uni, sans aspérité, de teinte chair, les lèvres pourpres, le sourcil fin et noir, substitut idéal de ce qu’il fallait cacher. Or, les accessoires de Dodgson différaient du modèle de Lippi : ils arboraient une chevelure de franges ou de raphia, agreste, primitive, révélant ainsi une origine exotique, dans un sens topique, du fait qu’ils reflétaient plus l’idée que l’Occidental se faisait du masque de sauvage Papua qu’une œuvre authentiquement façonnée par un vrai cannibale de la rivière Sepik. Phoébé, jamais en reste de perversion et de taquinerie, ne respecta pas les directives du révérend-mathématicien. Son drap presque tombant, ayant lors glissé au haut de ses cuisses, ne tenant plus que par miracle, elle usa de son masque comme d’un cache-sexe, plus exactement d’un visage pubien de démon-succube tels qu’on les rencontrait dans les représentations picturales des enfers au Bas Moyen Âge.
Dodgson se fâcha, l’apostropha, l’admonesta, car la petite catin usait de ce masque comme d’un éventail, éventant cette blonde intimité triangulaire troublante qu’elle cachait puis dévoilait en d’incessants va-et-vient de l’accessoire, vicieux, opiacés et nonchalants, comme si elle eût eu grand chaud. Il ne manquait à cet éventement que le bruit du déplacement de l’air, bruit qu’eût pu reproduire le grand Nikola Tesla, grâce aux artifices de l’électricité et du magnétisme, en produisant ainsi une musique électrique et acoustique du futur.
« Miss Phoébé exhibe trop son…son … Elle devrait re…remonter son…drap. J’ai beau la…la gronder…elle…elle n’obéit pas…n’est-il pas ? »
Cléore, salace, répondit avec des sous-entendus, prouvant qu’elle s’y connaissait en matière de gaudriole.
« Mon révérend, susurra-t-elle, vous voulez sans doute parler de ce que vous, Anglais, avez baptisé her she pussy-cat. »
Charles Dodgson en devint pourprin car il avait saisi les propos osés de la comtesse de Cresseville. Il fallut que Sarah rajustât elle-même le drap-draperie à la bonne hauteur du bas-ventre de la poupée-putain pour que tout rentrât dans l’ordre. Alors, Lewis Carroll prononça la phrase rituelle : « Ne bougeons plus ! ». Il se retint d’ajouter : « Le petit canari va sortir. » La poudre s’enflamma et fit un éclair ; les yeux des jumelles clignèrent, car éblouis : le premier tableau vivant était enfin photographié.
Vinrent lors Peinture et Poësie, de Francesco Furini. Nos deux galopines délurées purent dès lors prendre leurs dispositions pour cette deuxième photographie, ouvertement saphique. Les valets étalèrent à leurs pieds des paillassons de piassava aux motifs Liberty. Non pas qu’il fallût qu’elles s’y vautrassent : des sièges curules à la romaine, capitonnés de velours pourpre, furent dépliés sur ces paillassons et Dodgson demanda à chacune de s’y asseoir. On posa sur leur chef une couronne de lauriers. Daphné devait figurer la peinture, Phoebé la poësie. Dans le tableau original, il s’agissait jà de jumelles. Peinture, ses attributs en main (pinceaux et palette), devait enlacer Poësie qui tenait les siens (plume, stylet entre autres), dont un des masques de tantôt, tout en présentant frontalement son visage à Dodgson en effleurant la joue de sa sœur poëtesse de ses lèvres carmines. Face à l’objectif, prises d’un accès torpide, elles parurent s’abandonner à un engourdissement digne d’un fumeur de kif, que l’on dit aussi haschisch. Il était à craindre qu’à force de se mal conduire et d’afficher leur turpitude au grand jour, nos blondines ne provoquassent un esclandre. C’est ce qu’elles firent d’ailleurs, prêtes à un tumulte pis que l’ouragan d’un tempestaire de Pleumeur-Bodou. Phoebé-Poësie ne se gêna aucunement de bécoter Daphné-Peinture au cou et à la naissance de la gorge, en des mamours évocateurs. Elle descendit ensuite jusqu’au téton droit qu’elle suçota. Alors, le révérend explosa d’une saine colère.
« Mesdemoiselles, fulmina-t-il, ce n’est pas ain…ainsi que…que j’entendais que l’on po…posât ! »
Toutes à leur passion, nos deux coucous maigrichons se moquaient bien des préjugés victoriens du révérend Charles Dodgson. Si jamais il lui venait l’envie d’ébruiter, d’étaler sur la place publique ce qui se passait à Moesta et Errabunda, épreuves sur papier salé ou albuminé ou plaques de verre à la main, on l’accuserait lui –même d’être un pornographe et de véhiculer conséquemment des fadaises. On le traînerait peut-être en justice pour obscénité aggravée. Autour de lui, tout ne serait que querelles de quenelles entre puritains et partisans de l’amour libre. Sarah eut beau menacer les deux poupées de sa trique, rien n’y fit. Ce fut lors que Cléore commença à envisager une charte de bonne conduite et une échelle de punitions bien graduée, avec sarrau de bombasin et corrections publiques. Mais pour cela, il lui fallait imaginer une figure effrayante de mère fouettarde… L’origine de la Mère naquit à l’occasion des transports des deux sans-gêne sous les yeux de Lewis Carroll. Le temps de pose étant assez long, elles continuèrent à n’en faire qu’à leur guise, quelles que fussent les injonctions du mathématicien. Phoebé reprit son suçotement du mamelon droit de sa sœur, qu’elle transforma promptement en mordillements qui arrachèrent à la consentante enfant des gloussements de dinde en extase. Phoebé mordit si fort qu’elle fit saigner la mignarde mamelle saillante. Sa langue lécha les gouttelettes de sang qui perlaient du petit sein aux ourlets de sa bouche rosée et maquillée tandis qu’en réplique, de sa main gaillarde demeurée libre, Daphné s’insinuait sous le drap-pagne de son alter-ego afin d’attoucher et d’exciter indécemment ce que l’on devine. Dodgson était atterré par les mœurs débauchées des jumelles, dont les grands yeux cernés de petites filles fragiles au teint pâle semblaient lui jeter un défi.
Dépité, il se résigna à prononcer la phrase fameuse : « Ne…ne bou…bougeons plus. », plus bègue que jamais. L’éclair éblouit les deux perverses qui, enfin, s’interrompirent. Le plus difficile restait à faire : le dernier cliché, qui impliquait la nudité intégrale des modèles. En principe, elles eussent dû s’allonger en vis-à-vis sur deux sofas jumelés, l’une de dos, l’autre de devant, mais Lewis Carroll refusa que l’une ou l’autre montrât ses cicatrices de flagellation dorsales et les bleuissures de coups de trique des fesses. Elles furent donc disposées chacune de face, avec un éventail de plumes d’autruche, de casoar et d’émeu posé à l’endroit stratégique pubien. Elles s’anonchalirent sur de vastes peaux d’ours recouvrant leur sofa. Afin de se conformer à l’opus d’Alma-Tadema tout en le réinterprétant, Lewis Carroll fit placer en sus des bouquets artificiels d’œillets et de géraniums. Le révérend, qui en avait assez, expliqua qu’il comptait user d’un nouveau procédé d’émulsion inventé depuis peu, plus adéquat que le collodion humide qui commençait à dater : le gélatino-bromure d’argent, conçu en 1872 par Richard Leach Maddox et amélioré par Harper Benet afin que le temps d’exposition fût beaucoup plus rapide. Il se fit apporter un appareil plus petit et plus maniable, avec un nouveau système révolutionnaire d’obturation de l’objectif, qui permettait de faire des ouvertures dites à l’iris.
Il n’était plus temps de s’encolérer ou de s’acoquiner avec un ramasse-burette. Bonnes filles, Daphné et Phoebé décrétèrent une trêve des sens et firent la paix avec Dodgson ; elles avaient obtenu gain de cause. Elles savaient ne rien redouter ; nulle correction ne leur serait infligée pour l’heure… Le Tepidarium, pourtant si lascif du fait de l’audace de ses nus orientalistes d’odalisques impubères, fut lors le plus facile à photographier bien qu’il consistât en un manifeste de la nudité enfantine artistique faussement innocente, allant bien au-delà de ce que la décence anglaise permettait et exigeait. Il fallait s’attendre à l’avenir à ce que nombre de gentlemen portés sur les fillettes pratiquassent le rite d’Onan en leur cabinet privé, en s’extasiant sur la copie de ce cliché par eux possédée. Grâce à Daphné et Phoebé, les ventes de corsets de lutte contre l’onanisme masculin feraient des bonds incroyables.
Dès que le petit serin fut sorti, nos Dioscures femelles s’étirèrent sur leurs peaux d’ours en poussant des soupirs d’aise. Leurs petites bouches émettaient des mmm d’extrême contentement d’elles-mêmes, comme si elles eussent émergé de la douceur d’une relation charnelle. Une fois debout, Sarah s’empressa de couvrir leur pudeur de leur drap d’Aphrodite, car, marmottait-elle « tous ces étalages de chairs de vierges pré-nubiles concupiscentes avaient assez duré. » Elle leur ordonna de s’aller revêtir décemment après s’être lavées car leurs miasmes prégnants l’insupportaient. Mais Phoebé traînait des pieds. Elle s’adossa à un mur mitoyen au corridor menant à l’escalier principal du pavillon et jeta une œillade au révérend encore à peine vêtue de son drap. C’était une invite explicite au baiser furtif et à la caresse discrète osée. La fillette avait juré qu’elle se paierait la tête de Dodgson. Elle rabaissa de nouveau sa draperie sur son bassin, en dévoilant ses tendres pousses de poupée indécente. Par ma foi, c’était là une jolie manière d’aguicher notre hôte. Notre mathématicien se troubla pour la quatrième fois devant ce modèle tentant qui multipliait les avances torves et dont la translucidité opaline n’était pas le moindre de ses atours et de ses charmes.
« Embrassez mes petits seins, my friend. », susurra-t-elle en grasseyant sur le ton d’une mademoiselle j’ordonne s’amusant du pucelage d’un jeune fat acnéique. Phoebé s’arqua et se cambra, afin que ses tétins saillissent avec agressivité, dans une posture que Délia lui avait enseignée, tandis que ses mains achevaient de rabaisser son drap-pagne au ras de son pubis dont le duvet naissant, folâtre, brillait à la lueur d’un candélabre comme une abeille d’or. La petite gaupe gonflait et avançait ses lèvres pour administrer un suçon à Dodgson dont l’excitation masculine devenait insoutenable. Alors, en un geste brutal, inattendu, elle plaqua sa main droite en l’entrejambes de l’écrivain photographe, et, à travers l’étoffe de son pantalon, palpa et pinça ses parties. Un hurlement de douleur s’ensuivit. Attouché, presque violé par une petite garce de treize ans, Charles Dodgson la gifla sans retenue, jusqu’à ce qu’elle jouât de son côté petite fille et pleurât telle une jolie enfant gâtée capricieuse dont on aurait brisé la poupée Bru. En riposte, par esprit de revanche, Phoebé mordit le mathématicien à l’index droit dont elle lécha le sang. Elle ne cessa ensuite de jeter des menaces de sa bouche maculée à travers ses pleurnicheries hypocrites :
« Je le dirai à Mademoiselle Cléore qui vous punira et vous chassera d’ici ! On ne frappe pas impunément une baronne de Tourreil de Valpinçon, monsieur ! »
Daphné rappela à l’ordre sa catin gémellaire : « Phoebé, as-tu fini ? Viens donc, il se fait tard… Nous devons nous toiletter et rhabiller pour le souper. »
Une fois hors de portée des adultes, toutes deux pouffèrent, en petites filles dont les connaissances dans les matières choquantes étaient fort étendues pour leur âge tendre. Phoebé susurra à sa tendre moitié :
« Si un Anglais avait rapporté le juron que Dodgson a lancé lorsque j’ai pressé ses parties, il aurait écrit : « Shit ! he ejaculated. »
Tout se conclut par un effroyable éclat de rire alors que le duo démoniaque rejoignait sa chambre.
******************
Nos deux innocentines avaient conçu un langage secret, codé et fleuri, sorte de babélisme amphigourique qu’elles utilisaient pour consigner en des carnets intimes, reliés en cuir de Russie, écrits à deux mains, toutes les cochonneries et polissonneries auxquelles elles se livraient sans trêve. Afin de faire accroire à l’aspect anodin de leur chaude prose, elles renforçaient son inintelligibilité en y accolant des illustrations décalquées des chefs-d’œuvre enfantins permissifs de l’immortel auteur Teuton des inénarrables Max und Moritz. Les dessins humoristiques du sieur Wilhelm Busch qui avaient leur préférence étaient extraits de Die Fromme Helene, La pieuse Hélène, cruelle et cynique historiette satirique et antireligieuse d’une jeune ivrognesse brune au physique ingrat de lévrier Sloughi, qui priait la Vierge (et accessoirement feue sa maman) en promettant de ne plus jamais toucher à la dive bouteille. Cependant, in vino veritas : la bonne bouteille de vin sise près de la lampe à pétrole s’avérait si tentante qu’Hélène, abandonnant ses dévotions, y succombait et la vidait toute. Dans son ivresse, elle renversait le luminaire et périssait carbonisée : l’ultime dessin sarcastique et morbide de l’historiette moralisante et acerbe représentait l’âme de la jeune soûlarde s’envoler des restes consumés de son cadavre.
Cependant, Daphné et Phoebé noircissaient une telle quantité de carnets que ceux-ci n’y suffirent plus. Elles durent y accoler des paperolles, parfois récupérées de papiers aux usages les plus vils. Les deux empuses affectionnaient ces fameux rouleaux hygiéniques révolutionnaires importés du Reich bismarckien, ce qui fâchait Cléore. La comtesse de Cresseville les sermonnait, leur rappelant que mieux eût valu que des fillettes comme elles réapprissent à se torcher à l’ancienne. Il faut dire qu’usant du savoir-faire acquis auprès de leur oncle Dagobert-Pierre, Daphné et Phoebé excellaient à réutiliser lesdits rouleaux pour une utilisation moins triviale que celle pour laquelle on les avait conçus.
Adonc, il nous faut bien en venir aux crus et menus détails sur les mœurs particulières des jumelles. Elles n’aimaient pas seulement parfumer leur peau nue de chancissures antiques. Elles adoraient les épices, aussi. Vêtues de leurs seuls pantalons ajourés à triple ouverture érotique, elles se livraient ensemble à de longues séances de saupoudrage et d’assaisonnement de leur épiderme rose : elles saupoudraient torse, dos et abdomen de piment de Cayenne pilé, épiçant ainsi leur corps de sylphides, puis se léchaient à s’en enflammer les papilles et les sens. En anglais, on les eût surnommées spicy girls. Elles s’allongeaient l’une l’autre sur leur couche après que chacune eut pimenté sa mie, leurs bloomers fendus abaissés fort bas sur leur pelvis. Alors, Daphné et Phoebé partaient à la découverte tégumentaire l’une de l’autre, s’encourageant mutuellement de leur langue.
L’absorption de la poudre de piment ne tardait pas à produire ses effets. Filles en feu, elles s’abreuvaient lors et urinaient d’abondance. La valetaille avait dû équiper leur chambre d’une quantité pléthorique de baquets d’eau fraîche et de vases de nuit, sachant ce qu’elles allaient en faire. Perdant alors leur dernier vestige de pudicité et de bienséance, elles arrachaient l’ultime pièce de lingerie les couvrant encore – pour rappel, leurs pantalons brodés, festonnés et ouverts jà abaissés - et se mettant à croupetons, déversaient leurs flots urinaires alcalins aussi intarissables et insondables que le tonneau des Danaïdes, dans des coupes étrusques hellénistiques à engobe noir, des canthares ornés de figures noires dues au peintre d’Andokidès, ou encore des vases sigillés gallo-romains d’un beau rouge en provenance des ateliers de Lezoux et de La Graufesenque. Certains de ces récipients antiques étaient gravés de ciselures obscènes, d’une extrême lubricité, annonciatrices de ces décors de vases ou de coupes taillés au burin et rapportés par Brantôme dans son Discours premier des Dames Galantes, œuvres impures qui s’inspiraient des célèbres Positions de l’Arétin. On reconnaissait par-là des cadeaux d’Elémir, toujours lui. Les mictions incoercibles des jumelles en avaient pour des litres et des litres. Leurs intestins irrités et tuméfiés par l’abus d’épices de Calicut, de Cathay, du Coromandel, de Zanzibar, de Cipango et de Formose entraient ensuite dans la danse jusqu’à de malséantes manifestations de diarrhéiques sur lesquelles nous ne nous étendrons pas davantage, ne goûtant guère à Rabelais.
Sans trop s’en rendre compte, impures se croyant encore pures, Daphné et Phoebé contribuaient par leurs hauts faits à la déliquescence de Moesta et Errabunda. Qui mettrait la main sur leurs carnets intimes et parcourrait leurs pages et paperolles d’un œil indiscret, les huerait et vitupérerait, à condition toutefois qu’on en déchiffrât le code. Quant à Lewis Carroll, il avait renoncé à cette paire de petites diablesses auxquelles n’eussent manqué que les petites cornes, préférant terminer son séjour en parties de thé, de croquet, de volant et d’énigmes mathématiques avec d’autres amies-enfants plus acceptables : Jeanne-Ysoline, Sixtine et surtout la petite nouvelle Nelly-Rose et ses padous tout blancs. Séduit par sa mélancolie et ses grands yeux pleureurs, Dodgson ne cessa pas de la gâter et de la consoler en lui offrant de petits gâteaux anglais que l’on nomme cookies. La tristounette petite rousse regrettait encore la perte de son singe et de son orgue de Barbarie. Ce fut tout juste si le révérend ne manqua pas l’emmener avec lui tant elle était adorable et attendrissante.
La seule leçon que Daphné et Phoebé avaient retenue de leur rencontre avec Charles Dodgson était d’ordre technique : telle une Castiglione, elles se prirent d’une passion immodérée pour la photographie. Certes, outre les trois clichés vaporeux incriminés tantôt, dignes de Bilitis et de Sappho, avec leurs vestiges suggestifs de draperies grecques qui les dévoilaient plus qu’ils les vêtaient, sans omettre l’épisode de l’anandryne avec l’épreuve aux pelisses, les jumelles avaient dû se soumettre aux nouveaux rituels d’enregistrement des gamines instaurés par Cléore, à ses photos décrites plus haut. Cléore avait usé, comme l’on sait, des méthodes de catalogage de Monsieur Bertillon et de l’anthropologie physique de Paul Broca. Daphné et Phoebé s’étaient donc pliées à la mesure de leur angle facial et à celle de leur capacité crânienne – que Mademoiselle de Cresseville trouva bien supérieure à celle des femmes adultes ordinaires réputées fort idiotes - conformément au traité américain dit Crania Americana de Samuel George Morton, publié à Philadelphie en 1839.
Cependant, se prenant au jeu de l’œil de la camera oscura, nos Dioscures firent l’acquisition de leur propre appareil à la condition que Délia officiât tandis qu’elles se mettraient en scène. Elles avaient décidé exclusivement de fixer sur l’image leurs pratiques spéciales et démentielles à connotation saphique. Elles s’arrangeaient à être préalablement dans les vapeurs, ayant fumé un mélange extravagant mêlant opium, kif, bétel et nard. Ainsi ensuquées, comme l’on dit chez les Occitans, elles se préparèrent lors pour la première photographie en leur chambre boudoir sous l’œil attentif de Délia. Gaie comme un pinson, la jeune dépravée d’Erin admira Daphné déshabiller sa sœur à demi assommée par les stupéfiants, jusqu’à ce qu’elle ne conservât que bottines noires, bas, jarretières, pantaloons, et une sorte de mignonne chemisette de lingerie brodée toute légère, sans manches, lacée derrière, qu’elle laissa grande ouverte sur le dos afin qu’apparût la peau nue de Phoébé. Puis, elle suspendit cette dernière, qui gémissait, au lustre à girandoles, en l’attachant avec des cordages très serrés, de manière à ce que ses jambes pendissent sans tabouret ni escabeau pour retenir ses pieds. Tenue par la seule force de ses bras, la mignonne poupée en dessous, la peau des bras presque arrachée par la forte corde de chanvre, poussait de petits hululements de douleur et de plaisir. Lors, Daphné se saisit de l’arme de géhenne, un battoir à tapis, élargit l’ouverture de derrière des panties de coton de sa jumelle insigne jusqu’à déchirer cette fragile lingerie fine et commença à la raviver en la battant aux fesses et au dos, comme elle l’eût fait d’une perse empesée de poussière, en demandant à Adelia de prendre lors le cliché. Elle avait placé un vase de nuit de Delft sous les pieds oscillants de Phoebé, en prévision d’éventuelles excrétions inconvenantes qui ne manqueraient pas de jaillir de son entrefesson à cause de l’excitation provoquée par les coups de battoir.
L’afflux traumatique, thanatonique et érotique prodigué par le châtiment corporel savoureux rallumait l’éclat céruléen des prunelles de la jolie enfant jusque-là vitreuses et hyalines, ce qui trahissait son état de droguée. Plus les marbrures violines augmentaient, plus la sensation de délice submergeait notre jumelle. Daphné poursuivait sa tâche punitive, et, lorsque son œil exercé constatait la manifestation indéniable de l’extase sur le linge de Phoebé, elle cessait là. Tel un épulon présidant à la préparation d’un festin antique en l’honneur d’un dieu indigète gréco-romain, elle laissait s’extravaser des pantaloons, se déverser dans le vase de Delft le liquoreux cédrat de l’aimée-double, cette offrande, ce nectar mystique qui servirait d’oblation aux trois jeunes gosiers sis en cette chambre de bamboche. Il n’était point rare qu’à cette ambroisie ou à cet hypocras féminin se mélangeassent des sanies diverses de cette nymphe ne se retenant mie. Lors, Délia prenait une deuxième photo. Vidée, si l’on peut l’écrire, Phoebé retombait peu après dans son inertie d’opiomane.
Les personnes prudes, que je suppose offusquées et choquées par cette scène scabreuse et libertine, si elles se lassent de tout ce déballage inconséquent et complaisant de débauches, sont autorisées à sauter des pages et à se rendre à l’instant où Monsieur Nikola Tesla, le concepteur de la Mère, de la serre solaire, du double-transfuseur sanguin électrique et d’autres choses encore, entre en scène. Les autres, moins pudibondes, peuvent poursuivre leur lecture édifiante de tous ces éloquents et pétulants exploits de candides expertes d’à peine treize ans fêtés depuis quelques jours.
Adonc, pour les courageux et courageuses hypocrites (certains et certaines peuvent se voiler la face tout en feuilletant en cachette ce roman d’Ancien Régime), nos Dioscures de la nouvelle Gomorrhe aimaient à ce qu’on les liât ventre à ventre à l’aide de bandelettes de lin et de jute qui servaient d’ordinaire à confectionner ces fameux pagnes de fakirs hindous et autres brahmanes mendiants, réputés parcourir les campagnes en quémandant quelques roupies, moyennant une petite représentation de leurs tours. Ce pagne en bandelettes, immémorial dessous jà inventé sous l’Antiquité égyptienne, écru et moisi, les ceignant toutes deux, Daphné et Phoebé utilisaient encor Délie comme comparse de leur salauderie en lui demandant de leur apporter les différents instruments de plaisir doloriste. Nues à l’exception de leurs bas et bottines et de la saleté les entourant et les attachant telles des siamoises (en cela, quelques mois au-delà, ainsi que nous l’avons jà rapporté, Jeanne-Ysoline devinera leurs penchants), tissus pourris d’une teinte terreuse qu’on eût crus tirés de quelque momie de Psammétique rongée par l’humidité du Delta du Nil, les jumelles, disions-nous, désignaient à Délia, parmi les instruments qu’elle leur présentait sur un coussin de velours grenat, ceux ayant ce jourd’hui leur faveur sadique. Je ne vais pas vous faire accroire à une resucée du marquis de Sade mais vous exposer de nouvelles inventions de plaisir, héritées de l’Art pour l’Art et de l’exotisme anglomane du magasin Liberty. Sachez que lorsqu’on musarde et furette dans les docks londoniens, à Wapping, Whitechapel ou Limehouse, on peut mettre la main sur les objets les plus incroyables destinés à un commerce interlope clandestin tenu par des lords décadents, où l’ylang-ylang n’est pas le plus intéressant. Ces lords smugglers se livrent à une contrebande efficace d’objets exotiques on ne peut plus spéciaux, (du Liberty sous le manteau, si l’on veut) qu’on retrouve ensuite, acquis à prix d’or, dans des alcôves ou boxons encore plus spécialisés dans certaines pratiques…hem.
Adelia avait lors proposé aux jumelles qu’elles se cinglassent le dos à coups de trique, de tape-mouche, de cravache, de verges ou de fléaux chinois de Hongkong sur lesquels elles arrêtèrent leur choix. Ces objets asiates, appelés en japonais nunchakus, ressemblaient de fait à des fléaux à battre le blé, mais en réduction. Cependant, ils étaient chinois, car employés dans un art martial du cru, art qu’enseignaient des moines du douzième degré ou dan du monastère à bonzes dit Shaolin, qui arboraient comme tenue de combat une ceinture pourpre et noire nouée sur un kimono de soie. Nous savons qu’Elémir s’était inspiré pour les grades de Moesta et Errabunda, de ceux des arts martiaux de Cipango ou de Cathay. Le grade de Cléore correspondait de fait à celui du Supérieur de Shaolin ou Grand Maître. Les fléaux, pour eux, constituaient des armes de défense, non d’attaque, contre les rônins et bandits de grand chemin qui écument le Japon et la Chine. Importés par les Anglais depuis la guerre de l’opium, ils s’acclimatent désormais en France, pour l’us exclusif de certains lupanars pour lesquels la schlague s’est banalisée sous les assauts du raffinement de l’Aesthetic Movement. Ces fléaux sont noirs, fort durs, en un bois incorruptible, avec des chaînes d’acier. Ils nécessitent une souplesse, une dextérité et une promptitude de maniement nonpareilles. Il fallait croire que Daphné et Phoebé possédaient le don inné de la souffrance jouissive en manipulant ces choses. Elles se frappaient dorsalement l’une l’autre, à s’en rompre l’échine, multipliant les meurtrissures infâmes jusqu’à ce qu’elles fussent fourbues et s’effondrassent repues.
Daphné et Phoebé avaient pareillement inventé le déshabillage pianistique : vêtues en petites filles modèles, sans qu’aucun ruban ne manquât à l’appel, elles entamaient des œuvres à quatre mains de messieurs César Franck, Gabriel Fauré et Emmanuel Chabrier, car fort ouvertes aux sonorités de la musique moderne. Seulement, elles passaient leur temps à taper à côté, sachant qu’une erreur de note signifiait ôter une touche du clavier et une pièce de leur toilette. On devine qu’elles multipliaient les bourdes et qu’il est de plus en plus délicat de jouer sur un piano dépouillé de plus en plus de touches. Cet effeuillage s’effectuait devant les Dames attentives et obsédées par ce dévoilement progressif des appas de nos nymphes. A ce régime allègre et burlesque, il était inévitable qu’elles achevassent leur leçon de musique en fort petite et suggestive tenue. Résultat de tout ce schproum, Daphné se retrouvait le bas du corps à l’air à l’exception du gainage soyeux de ses jambes enfantines, la gorge cependant encore couverte d’une ravissante brassière de lingerie en gaze et mousseline toute vaporeuse et transparente, découvrant en sus le nombril de la belle enfant, et qui ne cachait donc pas grand’chose. Quant à Phoebé, elle était nu-torse et nu-jambes, n’ayant plus sur elle que ses seuls bloomers fendus de tous les côtés, où là aussi, ce linge de plus-que-nue permettait de tout admirer de sa grâce pré-nubile. Les jumelles, accoutumées à l’étalage de leur anatomie, ne s’empourprèrent point. Par contre, leurs oreilles perçurent l’extase des clientes, leurs soupirs dérangeants.
Quand elles étaient lasses de tous ces petits jeux turpides, nos sœurs tribades se retiraient dans le fameux cabinet aux poupées, où Cléore entreposait les effigies de cire des pensionnaires, collection qui ne cessait lors de s’étoffer à chaque nouvelle arrivante. En ce musée Tussau qui instillait une impression de malaise, elles contemplaient leurs répliques tel un Narcisse son reflet, s’extasiant du rendu exact cireux de leur exquisité de craie blonde translucide, de la quintessence de leur peau de malades chlorotiques et leukémiques, où l’artiste sculpteur minutieux était parvenu à reproduire le réticulé des vaisseaux sanguins qui transparaissaient sous l’épiderme de leurs tempes de fillettes post-fœtales et au dos de leurs mains. Elles touchaient et caressaient les joues décolorées, humaient aussi l’odeur passée et pulvérulente des tissus sciemment vieillis des robes empesées de ces poupées, ces damas et brocarts étiolés de pruine. Elles regrettaient cependant que Cléore ne les eût pas vêtues en Salomé. Daphné était tout de même fascinée par sa réplique en Claude de France, reine fragile entre toutes, tandis que Phoebé mirait la sienne en Marguerite d’Autriche, comme si elle se fût elle-même contemplée dans une psyché. Or, pour ne point accentuer le trouble de la tromperie, tous les miroirs du cabinet aux poupées de cire étaient sans tain. En tâtant le dessous des jupes de Claude de France, Daphné constata qu’elle arborait un trousseau complet, puis, poussant son exploration plus avant, réalisa ô combien ces reproduction étaient réalistes : il ne leur manquait même pas le sexe. Alors, comme obéissant au signal d’Onan, nos deux gourgandines se livrèrent à une nouvelle forme de débauche sur leurs reflets de cire damassés. Relevant leurs robes, elles commencèrent à se frotter contre leurs statues avec extase et frénésie, pratiquant sur ces alter-egos inanimés une singulière forme de viol. Lorsqu’une autre visiteuse s’alla admirer ces effigies (il s’agissait de Sixtine), elle remarqua que Claude de France et Marguerite d’Autriche avaient leurs vêtements en désordre, plus passés que de coutume, et semblaient singulièrement empoissées, leurs visages particulièrement. Daphné et Phoebé s’étaient bel et bien livrées à des choses indescriptibles sur leurs autres elles-mêmes…
Fascinées par les choses d’Asie, par les traditions érotiques sino-japonaises, Daphné et Phoebé acquirent sur leurs propres deniers d’étonnants objets d’amour. Elles volèrent même à Dodgson son baguenaudier chinois. Le temps est donc venu d’évoquer au passage l’affaire du Traité des massages siamois attribué au roi Po-Khun Ramkhamhaeng dit Rama le Fort ou le Hardi (1239-1317), traduit en anglais par Richard Burton et en français par Elémir de la Bonnemaison, ouvrage maudit à l’origine de deux assassinats : le premier ministre Spencer Perceval et le dramaturge August von Kotzebue, sans oublier la polémique artistique sans fin entre Ruskin et Millais à propos de ses gravures, authentiques pour Millais, faux grossiers pour Ruskin, qui en attribuait la paternité à William Blake et à Füssli. Sans doute cette querelle dissimulait-elle un bas motif de jalousie. John Everett Millais, dont John Ruskin avait constitué le soutien critique après qu’il eut défendu Turner, avait en quelque sorte volé la femme du critique d’art, Effie Gray. On sous-entendait que l’aversion de Ruskin pour les phanères intimes abondants et proliférants de son épouse avait été l’une des causes profondes de la rupture de leur union. Le point commun entre Spencer Perceval, assassiné par John Bellingham en 1812 alors qu’il était chef du gouvernement de Sa Majesté (plus exactement du Régent George), et Kotzebue, dramaturge devenu espion au service du tsar Alexandre 1er, qui avait été occis par l’étudiant en théologie libéral Karl Ludwig Sand en 1819, outre leur mort violente, était constitué par la possession du manuscrit du Traité de Rama le Hardi non encore traduit de l’antique langue Môn, traité dont la nature érotique était des plus connues et que les assassins convoitaient. Ce fut pourquoi Daphné et Phoebé, nouvelle excentricité onéreuse, exigèrent de Cléore qu’elle recrutât une authentique masseuse siamoise qui appliquerait sur elles les différentes figures extraites des illustrations de cet ouvrage, dont elles avaient déniché dans la bibliothèque de l’Institution un des exemplaires de l’édition française. Cléore, trop magnanime, céda à leur caprice d’aristocrates maladives. Ce fut Elémir qui lui envoya la masseuse, qu’elle dut payer cinquante francs or la semaine. La comtesse de Cresseville, de même que Délia, ne se privèrent pas de tels services émollients. La jeune siamoise (seize ans à peine) exécuta les figures de massage XV, XVII, XXI, XXIII, XXX et XLI, réservées aux femmes aimant les femmes. Les jumelles apprécièrent en particulier la figure XXX, dont il vaut mieux taire par décence en quoi elle consistait. La jeune Asiatique officiante, dont le corps, très menu, était à peine plus formé que ceux de ses vicieuses clientes, gazouillait dans son dialecte natal intraduisible, où les l remplaçaient les r. Cependant, ses éructations extatiques, quant à elles, lorsqu’elle accomplissait les gestes émollients pour lesquels on la payait, s’avéraient compréhensibles dans toutes les langues terrestres. Inutile d’évoquer dans le détail toutes ces figures caressantes et voluptueuses aussi imaginatives les unes les autres : il est plus que temps d’accélérer pour celles et ceux qui s’impatientent de Nikola Tesla.
Nous savons qu’il existe plusieurs types de petits objets de plaisir que l’on nomme communément godemichés. Certains sont dits simples et permettent à une Dame seule de satisfaire ses envies sans l’intervention d’une tierce personne. Mais, dans le cadre d’une relation entre deux Dames s’aimant d’amour tendre, le choix existe entre objet simple permettant à la Dame qui joue le rôle du Monsieur à combler d’aise sa mie sans toutefois qu’elle-même en éprouve quelque jouissance, et objet double, qui aide à l’assouvissement mutuel du désir. Cependant, certains objets doubles s’avèrent spécialement conçus pour Dames seules adeptes des pratiques solitaires intégrales.
Daphné et Phoebé de Tourreil de Valpinçon avaient de si dépravées coutumes qu’elles ne savaient plus comment jouir à deux : bien renseignées par les innombrables traités de toute sorte qui encombraient les étagères des bibliothèques infernales de Cléore et d’Elémir, instruites aussi par Adelia, elles avaient réclamé à cor et à cri que la comtesse de Cresseville leur commandât un objet tout neuf et innovant : l’objet quadruple, usité en couple. On annonçait jà d’autres innovations venues d’Angleterre, pour des instruments toujours plus onéreux, mus à la fée électricité à l’aide de petites dynamos de monsieur Zénobe Gramme, de piles électriques de Volta ou même de systèmes de bobines de Ruhmkorff. Ces appareils, pluriels ou uniques, dont on disait que la reine elle-même en avait acquis un, devaient vibrer au sein sacré des pratiquantes de ce vice, ainsi transfigurées par le plaisir d’une manière non anagogique. Mais Cléore n’envisageait point d’acheter sous le boisseau de telles inventions anglo-saxonnes, au coût prohibitif, quelles que fussent les réclamations des deux gourgandines. Elles durent donc se contenter d’un simple objet quadruple primitif en acajou précieux, teck, jacaranda et divers autres bois tropicaux tendres composites, gainé d’authentiques peaux humaines viriles provenant de sauvages Papua ou Pahouin tués exprès lors de parties de chasse immorales, ces peuplades étant réputées pour l’exaspération de leurs sens. La perfection de ce tétra-membre exigeait que les grands chasseurs blancs au casque tropical en liège occisent leur proie au moment où l’optimum de l’excitation du mâle était atteint et qu’ils l’abattissent avant que l’acte fût assouvi. Pour cela, il fallait qu’ils usassent de femmes-chèvres, des sauvages entièrement nues, qu’ils plaçaient comme appâts.
Dans une institution conçue pour perpétuer l’espèce des anandrynes, le refus de Daphné et Phoebé de n’aimer d’autres personnes qu’elles-mêmes comme on aime son reflet – ambivalence suprême – apparaissait à la semblance d’une pratique contre nature vouée à la stérilité. Singulière passion que celle-là, où chacune parvenait à s’accoupler en quelque sorte à elle-même, à ce reflet fait chair, à s’auto-satisfaire égoïstement en des rituels amoureux d’une inconcevable complexité, comble d’un raffinement érotique pervers qui marquait en son perfectionnement suprême l’apogée d’une civilisation vouée à l’art pour l’art, y compris dans ce qu’il a de plus trivial. Reflet…si semblable, si différent aussi de soi, si loin, si proche…
En quelque sorte, Daphné et Phoebé, contemplatives vicieuses d’à peine désormais treize ans, étaient les plus novatrices d’entre les nouvelles anandrynes, bien qu’elles ne pussent avoir aucune postérité immédiate. Elles avaient inventé le plaisir solitaire à deux. L’une était l’autre, l’autre était soi, moi était elle, je était nous…jeux troublants sans cesse recommencés où la fusion des doubles engendrait une unicité plurielle et neuve…
Après chaque emploi de leur jouet spécial, toutes deux exhalaient un fumet soufré des plus incommodants, mais propre à exercer une forte attraction sur les hommes, si toutefois nos poupées eussent été de la classique orientation sexuelle dite majoritaire. Ce fait est fort connu : la crasse et la fragrance des filles de joie attirent les messieurs comme l’aimant le fer, d’autant plus lorsque celles-ci sont d’âge encor tendre mais jà expertes. Elles jouent de leurs frous-frous, affichent leurs jupes sales, souillées et traînassantes avec ostentation. Déguenillées par leur vice, ces filles syphilitiques épandent leur contagion épidémique, pourrissant tous les cadres de la Gueuse qui les fréquentent avec assiduité. Ne sont-elles point elles-mêmes l’incarnation de cette Gueuse ?3
Heureusement pour elles, une déesse de la débauche semblait protéger les jumelles : elles ne mirent jamais la main sur le godemiché suprême, le seppuku de la geisha, car elles ignoraient la combinaison du coffre de Cléore, au contraire de Délie.
Daphné et Phoebé n’étant que deux, elles n’eurent jamais à utiliser d’autres catégories plurielles d’objets d’amour permettant à trois, quatre, voire jusqu’à six ou douze dames de s’encanailler en groupes pour ne point écrire en grappes. Imaginez d’ailleurs une grappe de raisin à laquelle on a enlevé tous ses grains et vous pourrez vous faire une idée par exemple des penta, hexa, hepta, octo, ennéa, déca, hendéca et enfin dodéca-jouets avec deux modèles différents pour ce dernier godemiché : celui conçu pour six dames et celui pour douze. On annonçait la prochaine importation d’Angleterre d’un objet encore plus délirant et révolutionnaire : le triskaidéca-jouet, soit jusqu’à treize tribades ou catins enfourchées sur le même instrument. A ce rythme, on pourrait bientôt mettre en grappe tout l’escadron des filles de joie du Chabanais pour un spectacle saphique onaniste unique !
Lorsqu’il plia bagage, Charles Dodgson s’aperçut que son baguenaudier avait disparu. Il songea d’évidence à un vol, mais ne put émettre aucun soupçon précis. « Bah, se dit-il, j’en acqu…acquerrai un au…autre. » Il ne conclut jamais à la culpabilité de Daphné et Phoebé qui profitèrent de ce petit larcin pour s’adonner à des expériences encore plus traumatisantes et exaltantes. Elles qui avaient l’habitude de lécher les blessures de leurs coups de fouet voire de s’amuser à s’arracher, parfois à coups de dents, des lambeaux de peau écorchés pendouillant de leurs plaies traumatiques, surent détourner le baguenaudier chinois pour le métamorphoser en inédit joujou. Le maniement de ce casse-tête nécessitait en temps ordinaire une habileté confondante ; ce que nos jumelles en firent eut quelque chose de presque surhumain, usage qui pouvait leur prodiguer des déchirures internes irréversibles voire létales. Elles ne l’expérimentèrent qu’une seule fois, et cela fut si douloureux et atroce que cela leur servit de leçon.
Une fois de plus, ce fut Phoebé que le sort désigna pour servir de consentant cobaye et de souffre-douleur. L’expérience du baguenaudier s’avéra si traumatique que la petite lamie fut victime d’une hémorragie conséquente, dont sa sœur empuse se régala, certes, mais à cause de laquelle elle dut demeurer un mois à l’infirmerie, son postérieur bandé après avoir subi une petite opération qui la mutila d’une partie de son intestin. Sur ces entrefaites, alors que nous étions en décembre 18**, Nikola Tesla arriva, mandaté par Cléore.
***************
Lorsque Nikola Tesla arriva à Moesta et Errabunda, la tragédie d’Ursule Falconet venait de s’achever.
Nikola Tesla, ingénieur et scientifique serbe, était à la fois le collaborateur et le rival de Thomas Alva Edison, notre Prométhée des temps modernes, qui a donné au monde les extraordinaires inventions du phonographe à cylindre et de la lampe à incandescence. Tous deux se querellaient et s’affrontaient sans cesse sur des questions de paternité de brevets et d’idées scientifiques, en particulier la question épineuse de l’opposition entre courant alternatif, dont Monsieur Tesla était un chaud partisan, et courant continu, option soutenue par Monsieur Edison. Le self-made man, ainsi que les Anglo-saxons le qualifient, avait une conception pragmatique de la science et des inventions : la science devait être appliquée, pratique et surtout rentable car pourvoyeuse de profit. Nikola Tesla, quant à lui, vivait davantage pour un idéal scientiste à la Monsieur Jules Verne, quitte à jouer avec le feu : il rêvait de casser l’éther luminifère, d’en percer tous les secrets ; il avait assimilé toutes les lois de Faraday, la théorie atomiste de Démocrite, la thermodynamique de Carnot et son second principe entropique, l’électromagnétisme de Maxwell et son fameux démon qu’il jurait qu’il l’apprivoiserait. Pour lui, tout était simple : la chaleur produisait de l’énergie et c’est parce que la lampe avait un filament incandescent qui chauffait qu’il y avait de la lumière électrique. Nikola Tesla prédisait qu’un jour, on parviendrait à casser la mécanique newtonienne et la géométrie d’Euclide, à les synthétiser avec l’électromagnétisme et la production d’une énergie intense issue des pompes à feu de Carnot et des dynamos de Gramme. Il prévoyait qu’on briserait un jour prochain la structure même de l’atome, donc de la matière : l’atome selon lui, malgré l’étymologie du terme, n’était pas insécable. Pour l’heure, la rupture entre les deux bouillants inventeurs semblait irrévocable : Nikola Tesla avait claqué la porte d’Edison pour contracter avec Westinghouse.
Cléore accueillit Tesla revêtue d’une toilette exotique d’une extravagance art pour l’art assumée : elle avait repris la vêture orientale du célèbre portrait de femme de Joseph Middleton Jopling, à l’exception des cymbales, remplacées par un tambour de basque aux bruyantes clochettes, à défaut de gong en bronze. C’était là une tenue polémogène, propre à susciter les interrogations voire l’hostilité, bien qu’elle ne constituât pas à proprement parler une invite à la fornication. Elle traduisait un refus profond de l’Occident dans ses aspects matérialistes industriels, au profit d’une vision exotique du monde vouée à la célébration de la beauté pour elle-même, dans ses aspects les plus contemplatifs. Cléore eût reçu l’ingénieur vêtue à la grecque ou à la pompéienne, comme dans les œuvres d’Albert Moore, qu’elle n’eût pas empêché l’exclamation émanant de la bouche de Tesla à la vue de cette éthérée excentrique : « Diable ! »
Cette robe de soie d’une pudicité affectée, du fait qu’elle enserrait l’impétrante jusqu’au cou, avait quelque aspect chamanique, d’une Chine archaïsante, venue des Trois Royaumes, à moins qu’elle n’évoquât les courtisanes de la cour hun, une Ildiko d’Attila ou tout autre personnage de l’époque des Empires Sassanide, du Kushan ou Gupta, avant qu’ils ne fussent attaqués par les Huns Hephtalites. Les broderies virtuoses recouvraient toute l’étoffe d’un bleu de roi pour les ignares, impérial de Chine pour les fins connaisseurs. Le motif du dragon et l’œillet ou Dianthus de Cathay marquaient ce vêtement de leur omniprésence. La toque céruléenne recouvrant les boucles rousses de la comtesse de Cresseville complétait ton sur ton ce déguisement bien qu’elle apportât une touche mandarinale et aulique de Cité interdite à l’ensemble. On eût pu, par quelque perversion, imaginer Cléore nue sous cette robe serrée qui parvenait à suggérer la volupté pulpeuse d’une gorge pourtant menue qui saillait malgré tout sous la moulante soie. En fait, la comtesse de Cresseville avait mis un corset fort ajusté et lacé sous cette tenue, ce qui permettait de faire accroire à ce qu’elle n’avait jamais eu. Elle avait multiplié bagues et boucles d’oreille en jade comme autant de parures typiques.
Curieuse, Daphné, esseulée, qui s’en revenait de visiter sa malheureuse sœur dont le protubérant et énorme pansement ornant son fondement meurtri faisait sur elle comme un pouf comique – quoiqu’il n’y eût absolument rien de risible dans l’affaire – commença comme à son habitude à sautiller sur ses bottillons guêtrés autour du visiteur en mendiant des bonbons et des sucres d’orge. Elle eût demandé à cueillir de la joubarbe en pleine mauvaise saison que c’eût été pareil. Tesla ne savait plus comment se débarrasser de ce cyclone vif-argent dont les rubans bleus et les anglaises s’agitaient sous les sautillements. Daphné babilla ses suppliques gourmandes en français, en anglais, en allemand, même en latin, toutes langues que le scientifique, polyglotte, comprenait et pratiquait, en bien prévenue catin censément au courant de la nature des inventions de l’ingénieur serbe puisque Cléore, Délie et Sarah l’avaient informée de cette visite dont le but était de superviser d’importants travaux d’aménagements électriques dans le domaine (et de créer la Mère, destinée à assurer la discipline allant lors à vau-l’eau et à incarner une sorte d’épouvantail pour les petites filles trop délurées portées désormais sur les plaisirs entre elles à défauts de ceux prodigués aux clientes). Dans la tête de Daphné, Tesla était un bien grand inventeur, qui à défaut d’Edison lui-même, serait le seul capable de concevoir des godemichés vibrionnants fonctionnant à la fée électricité. Notre savant moustachu chassa cette jolie et agaçante mouche enrubannée d’un revers de la main, avant de commencer son entretien avec Cléore.
Daphné s’alla lors quémander en échange une cajolerie à la comtesse de Cresseville, afin que celle-ci la consolât de sa déception. Loin pour une fois de céder à son ignominie, Cléore se saisit d’une férule et en frappa chaque main de l’enjôleuse empuse blondine sans que celle-ci eût grand mal ; au contraire, il sembla à Tesla que Daphné souriait sous les coups.
« Cet exemple vous démontre, ô combien, mon cher monsieur, que Moesta et Errabunda a grandement besoin de vos services. Il nous faut concevoir ensemble quelque épouvantail disciplinaire susceptible de calmer les tendances impulsives et peccamineuses de nos pensionnaires.
- Je comprrends », répondit l’ingénieur serbe dans un français un peu spécial aux rr redoublés.
Jamais en reste, la diabolique enfant revint une dernière fois à la charge, interrompant le dialogue sans nulle urbanité. Afin que Cléore la plaignît, elle toussa comme une cachexique tandis que ses grands yeux prenaient une expression languide. Elle opta pour le zézaiement qui l’infantilisait, ce qui prodiguait à ses paroles la valeur d’un discours de cacographe.
« Ze vous en zupplie, Cléore ; ze voudrais zuste un tout tout petit cachou… »
Ces mots furent tel un poudroiement de larmes de crocodile. Loin de céder, la comtesse de Cresseville avisa un petit carton sur lequel elle inscrivit au stylograph le mot italien bugiarda, ce qui signifiait menteuse.
« Qu’est ceci, ma mie Cléore ? s’étonna Daphné.
- C’est de l’italien. Cela veut dire que tu es punie et que tu dois faire comme dans Jane Eyre, t’aller porter ce petit panneau – non point par monts et par vaux, je n’irai pas jusque là – juste sous la gouttière de zinc qui coule dehors, à cause de la bonne pluie. Tu t’iras tremper toute, comme Sophie et Gribouille et montrer à toutes tes camarades que tu mens comme tu respires. Tu n’as point grand’faim. Tu ne fais que des caprices et tu es sotte comme une pécore à croire que je vais céder à tes avances foireuses.
- Z’est inzuste, Cléore ! Mieux eût valu que vous me punissiez !
- Tu ne crains ni trique ni knout car ce sont tes sources de plaisir partagé ! Tu n’attends que cela de ma part. Hé bien, je ne te frapperai pas… ne sois pas penaude. Allez, va, va, c’est assez ! Va jouer ! »
Un bref instant, Daphné sembla solliciter une caresse de sa maîtresse sur sa joue diaphane auréolée de rose. Mais l’apposition d’un doigt contre la ciselure de ses lèvres pourprées lui signifia : « Point maintenant…une autre fois, peut-être. » Lors, l’enfant s’éclipsa, l’iris embué d’une tristezza propre aux filles consomptives qui se meurent à Venise en quêtant l’air de leurs bronches blessées. L’écho de ses talons bottinés résonna, doux et ferme à la fois, dans le couloir dallé en damier.
Tesla en demeura abasourdi. Qu’était-ce que ce pensionnat étrange où l’on punissait avec des pancartes écrites en italien alors que les châtiments corporels semblaient prodiguer du plaisir à celles qui les subissaient ?… Il songea à Sade et à d’autres auteurs où le fouet tenait lieu d’argument littéraire…
« Désolée pour ce contretemps, Monsieur Tesla. Cette gamine n’est que menterie et malice…sa sœur jumelle aussi…et vicieuse avec ça ! Elles se vautrent toutes deux dans une telle licence que… Encore heureux que Daphné n’ait pas relevé ses jupes afin d’exhiber ses dessous. C’est bien parce que vous êtes là et que vous êtes un homme. Elle ne fait cela qu’avec les Dames…
- Diantrre !
- Si vous aviez été absent, Daphné se serait exprimée comme dans un roman licencieux du XVIIIe siècle. Elle apprécie fort la paillardise livresque, Sade, Restif de La Bretonne, Brantôme, Passereau et L’Arétin, notamment. »
Les paroles coquines de la comtesse firent rougir le savant serbe. Ce dernier connaissait certaines maisons closes new-yorkaises où, par pur voyeurisme, les clients se contentaient d’admirer, parfois deux heures durant, deux catins s’accoupler sans façon.
Mais la conversation prit lors un tour plus technique.
« Je dois vous exposer, Monsieur Tesla, mes projets exacts concernant cette maison d’éducation des petites filles aux vertus de Sappho et Bilitis, maison qui doit s’ouvrir à la modernité. »
Le savant n’en doutait plus : il allait œuvrer au service d’anandrynes mais sans aucun scrupule tant Cléore payait bien. Il émit une réflexion intrigante :
« Vous avez fait en passant allusion à une sœurrr jumelle de votrrre Daphné…
- Oui, Phoebé. Fort mignonne certes, mais je ne vous la recommande aucunement.
- Savez-vous que je songe à la duplication de l’être humain, à son transport instantané à distance par le biais des lois électromagnétiques de James Clerk Maxwell ? Imaginez un instant un prrestidigitateur, sorrte de Robert-Houdin, qui, usant d’une de mes inventions, parviendrait à dédoubler son ou sa comparrrse…cela créerait un extrrrraorrrdinaire prrestige pourr ce tourr de magie…
- Foin d’illusion, Monsieur. J’aurais besoin que vous inventassiez de quoi assurer l’ordre et la discipline en cette maison : vingt-deux filles, bientôt vingt-cinq, ça devient difficile à gérer. Elles se permettent trop. J’ai déjà décidé qu’on les séparera et qu’elles ne pourront dormir qu’à deux dans des chambres. Fini le dortoir commun où il se passe trop de turpitudes non théologales, d’attouchements entre vierges folles libidineuses juvéniles excitables et découvrant leur corps. La propriété est suffisamment vaste et le bâti bien pourvu aux étages en pièces aisément convertibles en chambres à coucher. Les lits, meubles et tout ce qui va avec sont d’ores et déjà commandés. Cependant, il faudra des compensations pour que l’Institution soit plus comfortable. Ainsi, nous devrons électrifier pas mal d’installations et améliorer le chauffage. Je souhaite créer une serre tropicale alimentée en bonne chaleur et de petits thermes à l’antique avec hypocauste… Nos gamines et nos clientes pourront s’y délasser… Quant à Daphné et Phoebé, j’avoue que leur santé m’embarrasse. Elles semblent ressentir un besoin perpétuel de sang frais. Elles souffrent peut-être d’anémie, de chlorose, ou de leukémia…que sais-je ? Que pourriez-vous essayer pour elles ? Sauvez-les. Bien que diablesses, elles ont droit à la vie… leur pitoyable joliesse…
- N’abusez pas du langage affété, Mademoiselle ; je sens bien que vous les adorrrez. Si vos petites jumelles sont si malades, il pourrait y avoirrr une solution : les trrransfuser, mais elles sont deux… oui…je vois…ce serrait forrrmidable…un apparreil électrrique ou magnétique de mon invention, qui perrrmetrrait une double trrransfusion simultanée des deux petites malades… la difficulté serra de trrrouver le donneurrr adéquat. L’existence de types de sang différrents relève pour l’heurre de la conjecturrre…4Quant au rrreste, cela fait beaucoup… En m’attelant sur-le-champ à la conception du tout, comptez bien, Mademoiselle la comtesse, trrrois mois de trrravaux. J’expliquerrai à Westinghouse que je suis sollicité pour une importante commande en Eurrrope et…
- Arrangez-vous pour que tout soit prêt avant la fin mars 18**.
- Entendu. Cela ne me laisse guèrre de temps. Mais je dois aussi concevoirrr votrre épouvantail à…
- …moinelles… Joli néologisme, n’est-ce pas ?
- Mes idées, Mademoiselle de Crrresseville, sont rrévolutionnairres. Ainsi, outrre votrre épouvantail, que j’entrrrevois commandé à distance, je vais conceptualiser une serrrre qui fonctionnerra à l’énerrgie du soleil.
- Je voudrais que l’objet de peur et de discipline ressemblât à…une Mère supérieure, vitriolée ou rongée par la lèpre…» interrompit Cléore.
Adonc, laissons se poursuivre cette discussion ; les résultats des travaux de Nikola Tesla, ce génie contemporain, vous seront exposés dans un prochain chapitre. Je juge qu’il est lors temps de reprendre le cours interrompu de notre intrigue présente et principale, alors que les nuages, en la personne d’Hégésippe Allard, s’accumulent au-dessus de Moesta et Errabunda.


































































































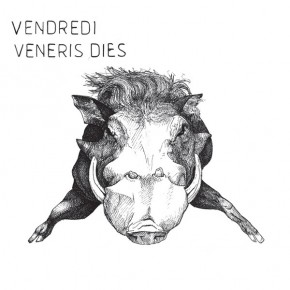


.jpg/640px-Titian_Venus_Mirror_(furs).jpg)



.jpg)



