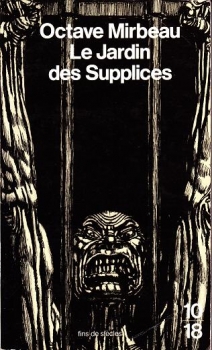La jeune fille avait mangé sans empressement ni enthousiasme une soupe aux lardons et un bon romsteak saignant à souhait, le tout accompagné de brie et de fruits divers juteux, abricots et reines-claudes notamment. Elle avait demandé à sa voisine, Stratonice, où se situait l’infirmerie.
« Au bout du pavillon de droite, au second étage, lui répondit la fillette d’un ton neutre entre deux louchées de soupe au lard. Je crois qu’il y a en ce jour trois patientes aux petits soins, ajouta-t-elle, d’un air presque blasé. Armance n’est pas venue manger avec nous. Elle se plaignait d’avoir mal aux dents. Je lui ai dit d’aller se faire soigner. Elle s’est exécutée en grognant de douleur. »
Odile se hâta de sortir du bâtiment principal de l’Institution et se rendit avec célérité au pavillon indiqué par Stratonice, un bâti néoclassique un peu décrépit, dont certaines pièces demeuraient désaffectées et servaient de dépotoir de meubles et d’objets usagés et dépareillés, y compris des instruments aratoires qui semblaient remonter avant 1800, notamment des vieux trains de charrues ayant appartenu à quelques coqs de village acquéreurs de biens nationaux sous la Révolution. Elle gravit les deux étages à balustrade du plus vite que ses jambes enfantines le lui permettaient. Lorsqu’elle fit son entrée dans l’infirmerie, elle s’attendait à quelque chose de sordide avec de la crasse, des amas de bandages souillés et de charpie immonde à même le sol, des flaques de sang, des odeurs de viande pourrie, comme dans un de ces hôpitaux militaires improvisés où gémissaient les blessés amputés, gangrenés et agonisants, selon les récits que son oncle lui avait faits de la guerre franco-prussienne.
Ce fut la fragrance des nouveaux désinfectants modernes qui l’accueillit. Odile eut la surprise d’une pièce spacieuse, avec des fenêtres et fenestrons, peuplée d’environ une douzaine de lits blancs, avec des rideaux, une literie irréprochable, un parquet propre, bien encaustiqué, et deux infirmières qui officiaient, deux jeunes femmes un peu sèches, au chignon sévère, à la tenue de nurses d’Outre-Manche, Marie Béroult et Diane Regnault. Certes, la peinture des murs s’écaillait quelque peu, bien qu’ils eussent été blanchis à la chaux. Le plafond, un peu haut, ce qui trahissait une pièce difficile à chauffer en hiver, rappelait la destination primitive de cette salle commune : les profusions de stucs et de peintures ridicules emplies de putti et de naïades dénudées dans le goût rococo de Boucher ainsi qu’une ancienne tribune réservée à des musiciens au fond, tribune où se rouillait un orgue, prouvaient que nous étions dans une ancienne salle de bal du temps du Bien Aimé. De même, avant la salle païenne avait dû exister une chapelle, vite laïcisée par la noblesse libertine de ce temps de débauches.
Comme elle l’avait prévu, seuls trois de ces jolis lits d’enfants malades étaient occupés. Dans le premier, Armance, une « rubans orange » aux cheveux mordorés et au visage de gros bébé, poussait des geignements de petite comédienne. Elle arborait une chemise de nuit beigeasse toute brodée et un vilain mouchoir jaune noué sur ses joues enflées par la rage de dents. Elle ne cessait de pousser des plaintes pathétiques, exagérant à dessein afin que les nurses s’apitoyassent sur son sort. Elle n’arrêtait pas de marmotter en pleurnichant : « Oh j’ai mal, j’ai grand mal ! Petit Jésus, que j’ai mal ! » Assise sur un autre lit, un peu plus loin, même pas changée en toilette de nuit, la jeune Hortense paraissait indifférente, très occupée à jouer aux bonshommes avec ses petits doigts pansés du matin. Cela lui faisait comme des nœuds comiques de tissu, et Hortense imaginait des petites historiettes, des personnages, soliloquant dans son monde intérieur, babillant sans fin ses saynètes naïves où chacune de ses extrémités jouait son petit rôle de Monsieur, de Madame, de Mademoiselle, de la vilaine maîtresse d’école qui punissait en frappant de sa férule ou du méchant gendarme de Guignol.
Dans le troisième lit pris, au fond de la salle, il y avait Jeanne-Ysoline. Odile s’adressa à la première nurse, Diane Regnault, une femme d’environ trente ans, une brune aux besicles sévères et plate comme une planche.
« S’il vous plaît. Je m’appelle…Cléophée (elle avait buté sur ce nom imposé) ; je suis élève euh ici et je souhaiterais rendre visite à Mademoiselle Jeanne-Ysoline de Kerascoët.
- Ici, on ne reçoit pas de visites, lui jeta d’un œil noir la revêche infirmière. Ordre de la comtesse de Cresseville et de miss Adelia.
- C’est que…Mademoiselle de Kerascoët est gravement meurtrie. Elle a grand besoin d’un soutien euh…moral. »
Elle cherchait ses mots, ne maîtrisant qu’avec difficultés la langue précieuse de ce lieu étrange et étranger, de ce microcosme voulu par Cléore de Cresseville, de ce nouveau Saint-Cyr. La nurse à la coiffe immaculée et au tablier d’un même blanc étincelant par-dessus une robe sans apprêts, mis à part des manches de dentelles, parut se laisser fléchir.
« C’est bon. La demoiselle est là-bas, au fond. Ne restez pas plus de dix minutes. Elle souffre beaucoup. Si nous n’y prenons garde, elle pourrait gravement s’infecter. Nous allons devoir la toiletter et renouveler le désinfectant et les bandages. Une de ses blessures s’est rouverte tantôt et nous avons dû l’étancher. Elle ne sortira pas de l’infirmerie avant plusieurs semaines. »
Tremblante d’émotion, Odile s’approcha du lit blanc dont elle tira légèrement les rideaux, lit où, allongée sur le ventre tant son dos et son postérieur étaient meurtris par la monstrueuse Délie, Jeanne-Ysoline avait repris connaissance. Le visage enfoncé dans un coussin moelleux, la jeune Bretonne murmura d’une voix à peine perceptible :
« C’est vous ma Cléophée, ma mie fidèle… Je sais que c’est vous. Mes sens blessés ressentent cela. Voyez comme Miss O’Flanaghan m’a arrangée et déshonorée jusqu’à mon intimité de jeune vierge. Je ressemble à une momie d’Egypte, n’est-ce pas, à une petite chatte sacrée embaumée par les anciens Egyptiens, un de ces minets momies qu’on voit, parfois, en certains musées d’égyptologie…Je suppose que vous êtes trop pauvre pour aller au musée… Pourtant, à Paris, le Louvre est gratuit. Je m’y suis souvent rendue dès que j’ai su lire.
- Reposez-vous. Essayez de dormir.
- Dans cette position, je ne puis, ma mie très chère. Je suis écorchée vive, mon dos n’a plus de peau et je ne peux me retourner. Et mes cheveux, mes pauvres cheveux…perdus. Jamais, depuis ma naissance, cette somptueuse parure n’avait été coupée. J’en…j’en étais si fière. C’est comme si…comme si on m’avait tondue à la manière d’un roi fainéant mérovingien privé de sa toison virile…pour m’enfermer comme lui dans quelque monastère.
- Je vous promets qu’ils repousseront encore plus beaux qu’avant.
- A propos de momies….
- Parlez moins, Jeanne-Ysoline. Vous vous épuisez.
- Je…je voulais vous reparler des chats. J’aime ces animaux tout en grâce et mystère. J’en ai eu un autrefois. Il avait un pelage soyeux, bicolore, noir et blanc. Je l’avais appelé Mignonnet. Autre chose… Feu mon grand-père, un jour, dans notre vieux château des Kerascoët, découvrit en notre cheminée un pauvre félin tout momifié dont la dépouille devait peut-être remonter à notre grand Roy Louis XIV…J’avais alors six ans.
- Vous avez besoin de repos. Vous avez perdu pas mal de sang. Ce spectacle me désole. Délie mérite un juste châtiment. C’est une barbare.
- Je ne désire point me venger, fit la jeune Bretonne dans un souffle. Par contre, ma Cléophée, entre nous deux, c’est désormais à la vie comme à la mort. »
Elle était entièrement nue à l’exception des bandages qui la recouvraient toute, sauf ses membres et son visage. Elle souffrait grandement, serrait les dents pour ne pas hurler. Le haut de sa tête, presque scalpé par Délie, était lui-même entouré de pansements encore tachetés d’hémoglobine. D’une des bandes du derrière de la fillette, fort malmené, on apercevait une macule sanglante allant s’élargissant. Tous ces amas de tissu vil voué à la souillure étaient si épais qu’ils en constituaient des sortes de saillies herniaires dorsales et fessières, des bosselures où le travail insidieux de l’infection post-traumatique, tout en prolégomènes, s’insinuait peu à peu, sans heurt, comme un exorde à la souffrance christique. A travers l’épaisseur de la gaze et du tissu, le pointillé des plaies causées par les pointes de métal du flagellum exsudait ses sanies séreuses. Les zébrures profondes et les trous mutilants de ces chairs enfantines disputaient leur territoire morbide immondiciel à la superficialité des plaies mineures, qui s’encroûtaient déjà sous l’effet de la coagulation, exulcérations et excoriations formant autant de mouchetures qu’une vérole épidermique de bâton de chaise à l’existence dissolue. Les balafres des lanières du fouet étaient sous les bandages comme autant de sillons d’où pouvait émerger, pousser, croître, une moisson de pus et de mort. Le dos de Jeanne-Ysoline était devenu à la semblance d’un livre ouvert sur la pourriture martyrologique, un psautier de la sainteté tracé sur les chairs mourantes, une inscription lapidaire épidermique de Graptoï byzantins écorchés, un dos voué à se corrompre, à se marbrer du noir de la gangrène. Mais les nurses veillaient. Elles œuvreraient afin que ces horreurs se désinfectassent toutes, se lavassent des sanies thanatologiques et n’entraînassent point la mise en bière prématurée de l’ange adorable qu’était Mademoiselle de Carhaix de Kerascoët.
« Infirmière ! Infirmière Béroult ! geignit la malade. Je sens se rouvrir une de mes plaies. Par pitié ! Seigneur, sauvez-moi ! »
Munie d’une seringue de Pravaz, la seconde nurse administra une dose de morphine à Jeanne-Ysoline qui tomba dans une semi torpeur.
« Nous allons changer ses pansements. Vous devez quitter cette salle, mademoiselle. »
L’enfant brune ne se fit pas prier davantage. Elle se résigna à prendre congé. Les lèvres d’Odile murmurèrent un « au revoir » que Jeanne-Ysoline, assommée par la drogue, n’entendit point. Par contre, tandis qu’elle s’éloignait de cette couche de torture, alors qu’elle ne parvenait plus à retenir ses pleurs, ses oreilles perçurent un bruit régulier et familier de claudication. La clopinante petite Quitterie lui faisait face, rouge comme un coquelicot, elle d’habitude si pâlichonne, essoufflée par tant d’efforts imposés à ses bronches si faibles, par ces deux étages gravis.
« Mademoiselle Cléophée ? l’interrogea-t-elle comme si elle doutait aussi de cette identité à la semblance d’une tromperie, d’une usurpation, d’un masque imposé par les autres, alors qu’elle avait été, elle, Berthe Louise Quitterie Moreau, l’ultime pensionnaire de Moesta et Errabunda à avoir pu conserver un de ses petits noms.
« Une…une cliente vous attend à la bibliothèque. C’est votre première visiteuse, je crois. »
Elle toussa à s’en arracher les alvéoles bronchiques. Cette fouine maladive avait grandement besoin de consulter un médecin au lieu de se soigner empiriquement avec des potions de grand’mère qui sentaient bien mauvais.
« C’est une bien belle femme, une étrangère. Elle est grande, fort jolie, bien habillée quoique assez spécialement. C’est une amie de Mademoiselle Cléore. Suivez-moi. C’est dans l’autre pavillon, au premier. Je vous accompagne. »
Elle fut prise d’un nouvel accès de catarrhe comme un vieillard atteint de bronchite. Puis, clopin-clopant, Quitterie fit quitter l’infirmerie et le bâtiment à Odile jusqu’au lieu de rendez-vous de la mystérieuse première cliente. Nonobstant les paroles d’Ysalis, qu’elle avait jugées fantaisistes et propres à un esprit dérangé et stupide, notre brune enfant allait enfin savoir ce qu’il en était de cette Maison dont elle commençait à comprendre l’extrême perversion.
![]() |
| Snow White |
***********
Debout dans la bibliothèque, accoudée à un confident de ces dames datant de Napoléon III, tout capitonné d’un velours d’une nuance vert tendre, miss Jane Noble, trente-quatre ans, de nationalité américaine, fumait nerveusement une longue cigarette roulée dans du tabac de Virginie en attendant celle dont le message de Cléore, que Julien lui avait communiqué tantôt à l’hôtel, lui avait parlé avec tant d’éloges.
C’était une femme à la chevelure brun clair, de ces bruns subtils d’Anglo-Saxonne tirant sur le marron soutenu qui se mordore parfois au soleil des rives du Potomac. Son teint était rose, ses yeux d’un bleu de pervenche. Une brune avec une peau et un iris de blonde, mais tellement plus belle ainsi. Sa stature était élevée pour une femme, bien qu’elle conservât en sa silhouette grâce et harmonie car, sous la toise, miss Noble atteignait les cent soixante-quinze centimètres. Elle incarnait le type même de la femme émancipée. Appartenant à cette élite bostonienne tant vantée par nos viragos nationales, miss Jane Noble s’adonnait au journalisme, à la littérature et au militantisme politique au sein de clubs très actifs, très revendicatifs, non seulement en faveur du vote des femmes, mais aussi de leur libération morale, économique et sexuelle. Dans un célèbre article scandaleux de la Boston Gazette où elle officiait, elle s’était faite l’apologiste de l’ouverture de lupanars pour femmes, non seulement des maisons closes où ces dames fraieraient avec des prostitués mâles, mais aussi des établissements purement destinés aux pratiques saphiques vénales. Jane Noble se vantait à qui voulait l’entendre qu’elle avait été déniaisée par une tribade à l’âge de dix-sept ans. Sportive émérite, elle pratiquait le lawn tennis, l’équitation, la natation et la gymnastique suédoise.
Impatiente de lier connaissance avec ce jeune esprit rebelle qui, elle le pressentait, était pareil au sien, un de ces esprits militants de l’égalité des sexes, perpétuellement en révolte contre l’arbitraire masculin, qui constitue la sanior pars de la légion des meilleures partisanes du droit de vote des femmes, miss Noble se contraignait à ronger son frein en s’imposant la contemplation forcée du décorum chargé de cette pièce baroque et confinée, obligeant le saphir de ses prunelles à s’attarder sur les boiseries de palissandre, sur les lambris et les rayonnages de chêne, de cèdre et de bouleau, sur ces perses à ses pieds, tout en arabesques et figures stylisées indéchiffrables, ou encore, sur ces tapisseries, l’une d’Aubusson, l’autre des Gobelins, qui toutes deux partageaient la commune évocation d’un épisode de l’Hombre de la Mancha, ce Don Quichotte qu’elle admirait au nom de la transgression et de la destruction créatrice de l’ordre ancien.
Non pas qu’elle souffrît d’un abus de donquichottisme. Elle n’en dégustait que l’épicarpe, la peau du fruit, abandonnant à d’autres fanatiques de la compassion et de l’altruisme la pulpe interne, la chair de la pêche juteuse.
Cependant, miss Noble fatiguait. Sa langue s’épaississait ; elle n’avait absorbé ni laudanum, ni chloral depuis la veille au soir, et cela l’importunait. Elle avait besoin de se rafraîchir le corps et les idées et regrettait qu’elle ne fût point le Palémon, ce personnage mythologique changé en dieu marin qui eût trempé avec délice dans toutes sortes d’eaux émollientes. Le violent tabac brun dont elle abusait, au nom de la liberté des femmes, desséchait ses muqueuses et son gosier et gâchait son haleine : elle avait grand besoin d’une bonne gorgée d’absinthe, elle qui goûtait en esthète à l’encanaillage des assommoirs.
Les dos des maroquins, qu’ils fussent de cuir ou d’autres matières, rouges, verts, bleus ou ocres, ne l’intéressaient aucunement. Trop d’obscénités composées par des mâles, de leur point de vue exclusif, peu d’auteurs nouveaux, à l’exception d’un Oscar Wilde en langue originale, cet auteur déroutant qu’elle avait rencontré à Londres l’an passé.
En cette pièce suant l’ennui et le confinement, bien qu’elle fût égayée par les plantes vertes, les vivariums et les aquariums qui en humidifiaient l’atmosphère à la semblance d’une minuscule portion de forêt vierge, miss Noble se retrouvait bien démunie, n’ayant pas encore éprouvé le besoin d’injecter dans ses veines, par le biais d’une petite seringue de Pravaz, cette salvatrice solution à sept pour cent qui décuplait ses facultés créatrices et son imagination dépravée.
Elle était donc belle, grande, bien constituée, désirable quoiqu’adepte de Sappho. Les hommes aimaient à la contempler, à la dévisager, à cause de son teint de lys et de son iris bleu qui contrastaient avec ses boucles brunes, mais elle les détestait, les rabrouait lorsqu’ils se faisaient par trop entreprenants, se complaisant en la seule compagnie des femmes. Monsieur Manet ne s’était point trompé sur sa beauté ; lors qu’elle avait à peine vingt-trois ans, tandis qu’elle séjournait en dilettante en la patrie de La Fayette – ses sentiments francophiles étant fort appréciés en haut lieu – il l’avait peinte en compagnie d’un monsieur, un séducteur, qui l’avait rebutée. Elle avait posé dans une robe grise avec de discrètes passementeries bleutées. Le soir de la première séance de pose, à des fins de revanche, elle avait partagé la couche de Valtesse de la Bigne, comme par défi contre la grande bourgeoisie, qui était pourtant sa propre caste en Nouvelle Angleterre. Depuis, même si les rouages du temps semblaient inopérants sur elle, quelques signes annonciateurs, qui eussent dû l’alarmer, elle qui avait la vue fine, commençaient à marquer deçà-delà son cou et son visage blancs. Son épiderme se teintait d’un hâle indiscret, propre à celles qui s’exposent trop au soleil ; ce cou si pur s’épaississait ; le menton tendait à s’alourdir, les yeux à se cerner. Les joues, quoiqu’elles demeurassent rosées, pelaient parfois et se chiffonnaient, bien que ses mains d’albâtre d’une merveilleuse finesse et d’un velouté doux les soignassent et recourussent de plus en plus fréquemment à l’usage des crèmes, onguents et autres pâtes de beauté trompeuses. Mais l’iris d’azur demeurait intact dans tout son éclat céruléen et là était l’essentiel pour celles et ceux aveugles à percevoir les premier stigmates du vieillissement de la femme. La vie agitée qu’elle menait à Boston ou ailleurs, en féministe, journaliste et écrivain cosmopolite de talent, en bambocheuse aussi, était la seule chose qu’elle eût dû incriminer dans la fatigue de la face et l’amorce de flétrissure de cette beauté de brune claire.
Pourtant, Jane Noble n’était point un de ces personnages droit sortis d’un roman de Mr Henry James. Son élégance battait le haut du pavé tant elle était novatrice. Entre autres choses, elle abhorrait toute autre couleur d’étoffe que le bleu électrique, signe chromatique selon elle de la modernité. Contradiction avec sa toilette, pourtant fort bien, arborée sur la toile de 1879, et qui lui seyait à ravir. Ce refus obstiné de toute autre nuance tinctoriale dans ses vêtements tourna à la monomanie. Elle ne trouva aucune exquisité, aucune seyance aux tissus d’autres couleurs que ce bleu électrique obsessionnel et moderniste. Porter autre chose eût été selon elle comme se vêtir de chiffons d’étoupe ô combien inflammables, d’un justaucorps poilu d’homme sauvage, de velu médiéval du Bal des Ardents de Charles VI le fol, massue cloutée en sus, ou encore tel un de ces jacquemarts barbus et hirsutes de l’horloge de Saint-Marc à Venise, avec leur maillet et leur pagne de peaux de bêtes. Tout en devint monochromatique sur son corps, du linge intime, des déshabillés et négligés jusqu’aux bottines et aux gants de suède bleue. Elle équipa chez elle toute sa literie, ses dentelles et ses rideaux et tentures en bleu. Elle mit du bleu d’Espagne sur ses lèvres, poudra de bleu ses joues, vernit ses ongles de nacre bleue, teinta de reflets bleus ses boucles. Elle eut même l’idée de peindre son épiderme en bleu, voire de faire injecter dans son hémoglobine un colorant azur qui eût constitué la preuve sidérante que du sang de patricienne de Boston coulait dans ses veines et qu’elle était bas-bleus, corps bleu et ventre bleu ; mais elle se ravisa à temps. Elle exigea bientôt que l’on peignît, coloriât et teintât sa nourriture en bleu, de cette nuance bleu sombre dite kuanos chez les Grecs ou cyan en Amérique. Elle se fit servir des steaks bleus, des rôtis bleus, des pâtisseries bleues, du maïs bleu, des potages bleus, du poulet bleu, du bleu d’Auvergne, des Causses, du roquefort en abondance, du vin bleu, de l’eau minérale bleue, des entremets bleus, des oranges bleues…jusqu’à ce qu’elle s’en lassât et fît marche arrière de peur qu’on la jugeât aliénée et bonne pour le lunatic asylum. Elle s’arrogea donc des exceptions dans ses tenues, adoptant de nouveau des dessous blancs ou beiges, s’accordant çà et là des licences aux édits somptuaires ridicules qu’elle s’était imposés : foulards, gants, chapeaux, bottines et réticules recouvrèrent des couleurs plus classiques et conformes aux bonnes mœurs, aux bons us, sur sa petite personne de girafe bostonienne.
Cependant, loin d’être assagie, miss Jane Noble fut frappée de nouvelles lubies innovantes portant non sur la teinte, mais sur la forme et la coupe de la vêture de dessous et de dessus. Elle se mit à bannir, à ostraciser les fioritures, les fanfreluches, les dentelles, les falbalas inutiles, tout ce qui faisait d’une femme une cocotte de luxe ou de demi luxe, poussant son habillage jusqu’à l’épure cistercienne. Puis, elle s’affranchit du corset, de la chemise et des pantaloons, exigeant que toutes les Bostoniennes les brûlassent solennellement comme si c’eût été une nouvelle tea party. Elle remplaça ces stupidités de catins par des dessous révolutionnaires limités à deux pièces minimales en plus des bas : une sorte de brassière à baleines qui laissait ventre et nombril nus et des bloomers très courts et bouffants, avec un empiècement triangulaire juste au milieu et une double rangée de boutons sur les côtés, d’un boutonnage dit à ponts, bloomers croustillants et impudiques nommés culottes ou pants, qu’elle bourrait de crins fort urticants afin d’empêcher que les mâles la pelotassent. Par-dessus ces pants, elle enfilait une sorte de compromis révolutionnaire entre la jupe et le pantalon masculin, long, flottant, avec un entrejambes, qu’elle baptisa jupe-culotte, qui lui facilitait l’équitation et la pratique du vélocipède, dont de nouveaux modèles à pédalier médian se répandaient et qu’elle appelait bicycles.
Par égard pour les gamines de Moesta et Errabunda, Jane Noble s’était ce jour là assagie, optant pour un ensemble certes bleu électrique et dépouillé, mais à jupe longue véritable, avec un vrai jupon de percaline et de satin dessous. Concession arrachée par le conservatisme vestimentaire gaulois de cette bourgade de province ou volonté que les fillettes ne se choquassent point de sa tenue ? On ne sait. De lourds pendants d’oreilles en ambre jaune déformaient ses lobes. Elle écrasait nerveusement chaque mégot dans un cendrier d’étain gravé d’un listel féodal de sa main droite baguée. En lieu et place de l’alliance protestante qu’elle eût dû porter si elle eût convolé, son annulaire destiné à l’anneau nuptial arborait une chevalière sertie de lapis-lazuli enchâssée d’une topaze. Sa jolie tête était coiffée d’un étrange turban de soie damassée et de satin, comme une maharani jouant au rajah, turban d’une teinte violine au milieu duquel était inséré, telle une applique, un petit bijou de jadéite, taillé d’une pièce, à l’effigie du dieu éléphant hindou Ganesha, ornement duquel partait une aigrette de plumes de Paradisier. Miss Noble trépignait toujours plus. Avait-elle eu raison d’envoyer cette boiteuse quasiment phtisique, cette Quitterie, à la recherche de la fameuse Cléophée que le message de Cléore lui avait tant vantée ? Le cendrier jà débordait. Elle le repoussa d’un geste méprisant de la paume jusqu’au bord du reposoir de santal d’où il manqua choir.
Elle se leva du confident capitonné et arpenta la bibliothèque. Ses yeux s’arrêtèrent sur un bouclier d’impi zoulou, sorte de trophée de chasse ramené par quelque Boer belliqueux après la bataille de la Blood River contre le roi cafre Dingaan. Elle chercha sa blague à tabac et s’aperçut lors qu’elle était vide. Résignée, Jane tira d’une poche de son corsage bleu électrique, nous vous le rappelons, corsage boutonné comme une jaquette d’homme, un étui d’ivoire sculpté à ses initiales, J.N., cadeau de Paul de Cassagnac, étui duquel elle extirpa un long et fin cigare de Hollande qu’elle coupa et qu’elle plaça dans une sorte de tube d’ambre et de nacre qu’elle mit dans sa bouche avant qu’une nouvelle allumette grillée en eût provoqué l’ignition. Tout en poursuivant sa marche agitée et en tirant maintes bouffées, la jeune femme prêta enfin attention aux contenus des aquariums et des vivariums dispersés dans ces aîtres. Le liquide des cages de verre destinées aux êtres aquatiques glougloutait et bouillonnait comme homard à l’étuve. Intéressée par les tragédies viles qui se déroulaient et s’accomplissaient dans ces prisons miniatures, fascinée par la laideur des bêtes qui s’y terraient, Jane goûta à des combats, des duels homériques, des bestiaires dignes d’un amphithéâtre Flavien en réduction. Elle s’amusa à exciter les animalcules immondes qui s’entredéchiraient par des ksi ksi, comme s’il se fût agi d’un combat de boxe anglaise. Ses doigts tapotaient les vitrages, embêtant ces bestioles répugnantes qui vaquaient à s’entredévorer. Elle parcourut des fragments de duels : myriapode contre scorpion, limule contre araignée de mer, blatte mexicaine contre mygale ou tarentule qui tissait ses arantèles d’aragne, scolopendre contre lézard Moloch. Elle remarqua même un aquarium où cohabitaient murènes et piranhas, bien trop calmes à son goût. Sans doute ces prédateurs étaient-ils repus. Comme peu satisfaite de la victoire par trop facile de ce nouveau gladiateur qu’était le scorpion noir, elle tira de son réticule un petit gantelet de fer, l’enfila en la main droite, ouvrit la cage du gagnant et l’en tira, le maintenant par la queue, juste au niveau de l’aiguillon et de l’ampoule à venin, temporairement vidée contre le myriapode. L’innocuité des piqûres répétées du petit monstre contre le fer de sa protection articulée la fit ricaner comme une sadique. Miss Noble arrosa le sable du sol de la cage avec une fiasque de gin qu’elle conservait toujours sur elle, de manière à ce que le liquide fort formât un cercle. Avant qu’il eût été absorbé par le revêtement sableux de ce fond, elle craqua une allumette et la jeta, en feu, sur l’alcool épandu. Le cercle enflammé, elle reposa précautionneusement en son mitan le laid arachnide qui, cerné, n’avait plus d’échappatoire. Comme dans ces célèbres figures alchimiques symboliques des traités arabes, le scorpion n’eut plus qu’à se suicider en piquant son tronc encéphalique avec le reste de son venin qui de nouveau se sécrétait. Alors, Jane Noble se surprit à rire à gorge déployée, dans un de ces accès d’infantilité cruelle qui la prenait parfois, comme quand elle se distrayait à faire éclater des crapauds en les bourrant en pleine gueule de ses cigares incandescents. La main de Quitterie, qui frappait l’huis, interrompit cet épanchement de contentement pervers.
![]() |
| Night Visit |
***************
« Entrez, entrez donc… » fit la voix de Jane Noble.
Elle s’exprimait dans un français parfait, avec un soupçon d’accent anglo-saxon fort harmonieux cependant, un de ces accents de la Nouvelle Angleterre, de l’élite Vieille Europe, que l’on dit encore plus snob, apprêté et distingué que celui de la upper class d’Albion.
La petite Quitterie n’en pouvait mais. Elle grimaçait de douleur comme une bégueule bigote choquée par un nu indécent du Salon des refusés. Elle était toute bancroche d’avoir par trop marché et parcouru couloirs et escaliers. Son appareil orthopédique la blessait, lui occasionnait mille tourments doloristes ; les tiges de métal de sa bottine bote lui entaillaient les chairs, commotionnant cette frêle enfant. Son derme apparaissait livide, terne, cadavéreux et pourpre à la fois. Elle haletait telle une chienne excitée, son linge intime détrempé par ses suées de poitrinaire.
« Pas vous, Mademoiselle Quitterie, lui intima miss Noble sur un ton impérieux qui n’admettait ni objection ni supplique. Je désire voir Mademoiselle Cléophée seule à seule. Retirez-vous.
- Bien…euh…miss », toussota la gamine maladive en reculant avec rectitude.
Odile la remercia de l’avoir conduite à bon port et lui murmura :
« Reposez-vous, pauvrette, vous en avez grand besoin... Vous faites pitié.
-Mer…merci Cléophée, vous êtes bien bonne. »
Elle s’en alla, tortue et de guingois, trébuchant presque à chaque pas, comme une ivrognesse. Ses quintes déchirantes emplirent le corridor, résonnèrent un instant, même lorsqu’elle fut sortie du champ de vision d’Odile qui émit quelques larmes d’une colère rentrée à ce spectacle lamentable. Elle craignait que la pauvre belette ne passât pas l’hiver. Son empathie accrue pour plus misérable qu’elle la perturbait. Etait-ce cela, l’amour entre filles ? En moins de vingt-quatre heures, la compassion s’était jà manifestée trois fois en elle. Elle se surprenait à éprouver autant de componction et d’affliction à l’encontre de personnes encore inconnues un jour auparavant. Marie, Jeanne-Ysoline, Quitterie… Qui serait la prochaine ? En entrant dans la bibliothèque, elle pensa :
« Je suis sûre que cette dame l’a fait exprès de demander à Quitterie de venir me chercher. Elle semble se complaire au spectacle de la souffrance. Je l’ai vue sourire. Je la pressens dangereuse, comme mesdemoiselles Cléore et Délie. »
Comme pour confirmer ces réflexions en son for intérieur, miss Noble, une fois la porte en boiserie capitonnée de vert poussée, s’empressa de la boucler à clef.
« Les femmes racées sont les plus ambiguës et les plus vénéneuses. Je suis sur mes gardes. » put se dire Odile à la vue de cette Américaine adonisée avec goût et recherche, presque excentrique dans sa sobriété provocante. La pièce était enfumée par le tabac et la fragrance des cigarettes et du cigare consumés irritait la gorge de la jeune fille qui ne put retenir sa toux.
Miss Noble agita une clochette d’argent ; d’une alcôve dissimulée par un panneau émergea une domestique affreuse comme un carlin, une Indienne apparemment, profondément ridée, fripée, frappée qui plus était d’une mutité pathologique à moins qu’elle fût chirurgicale.
« Elle pousse la méchanceté jusqu’à couper la langue de ses servantes afin qu’elles ne cèlent rien des salauderies qu’elle doit commettre, songea Odile. Je dois donc m’attendre à tout. Soyons courageuse. »
La menine, Séminole ou autre, portait deux grandes sacoches de cuir distendues par leur contenu inconnu. Jane la congédia, une fois ces paquets parcheminés et ridulés de vieille croûte de vache déposés sur une grande table d’ébène et de marbre, dont l’entablement, telle une corniche, formait une bordure moulurée, porphyrique, d’une couleur malsaine d’entérite, annonciatrice de diarrhées sanglantes, tels ces croisés frappés de dysenterie souffrant de l’antique maladie de l’ost, dont les braies, ouvertes, permettaient l’écoulement permanent de leurs matières viles en liquéfaction putride, sans qu’ils s’assissent sur une latrine improvisée.
La lady américaine reprit la parole :
« Je me présente Jane Noble, écrivain et journaliste féministe à la Boston Gazette, pythonisse aussi. How do you do, miss ? »
Elle tendit à main à Odile, comme un homme. La petite fille, qui ne connaissait rien à l’anglais, fut bien obligée d’accepter ce shake hands anglo-saxon.
- Euh…Je m’appelle Cléophée, du moins, c’est ce prénom qu’on m’a attribué hier depuis mon arrivée. En fait je suis Odile Boiron…
- Peu me chaut mademoiselle ! Déclinez votre âge, c’est tellement important pour moi !
- Il me semble bien que... Ben, j’ai onze ans !
- Soyez plus précise, minauda sèchement la féministe. Ne jouez pas l’empotée avec moi !
- Mon anniversaire est passé le 28 février, mais j’suis si pauvre qu’on ne le fête jamais.
- Où êtes-vous née ?
- A Paris, à Belleville, et mon père, il est mort quand j’avais sept ans. J’ai un parâtre violent…»
Odile était gênée par cet interrogatoire indiscret.
« Savez-vous pourquoi vous vous retrouvez ici ?
- Non, pas du tout. Mes souvenirs demeurent brumeux, vagues, comme s’ils remontaient très loin.
- Votre…hem, disons le concubin de votre mère…
- Ben, mon beau-papa.
- Que faisait-il ? Pourquoi avez-vous dit qu’il était violent avec vous ?
- Il était tout le temps saoul, de retour du cabaret. Il me battait et il battait aussi maman. Hier euh…il…il…
- Libérez votre parole, mon enfant !
-…il a voulu me violenter ! J’ai…j’ai fui sous la pluie, avec un vieux parapluie à maman ! J’ai erré dans les ruelles de Belleville, je sais plus…
- Tu étais hagarde, trempée par l’orage…
- J’avais le parapluie…j’me souviens plus trop de la suite avant la voiture obscure où la petite Marie pleurait. Il y a eu cette borgnesse qui puait…puis, plus rien avant la voiture bâchée. »
Odile fut décontenancée, déstabilisée par le brusque recours de miss Noble au tutoiement. Pour une Anglaise ou une Américaine, pour qui le thou ne s’emploie qu’en poësie ou pour désigner la Divinité, cela représentait un effort notable qui démontrait la tentation de se mettre au niveau de la petite Française.
« Je vais te parler franchement, Odile, Cléophée ou qui que tu sois. La borgnesse, c’est une rabatteuse au service de Mademoiselle Cléore de Cresseville…et Cléore est mon amie. Nous défendons toutes deux la cause des femmes et accessoirement, celle de l’amour filles-femmes. En plus de mon métier de journaliste, de ma carrière de romancière, je pratique aussi à mes heures – oh, en dilettante seulement – un art bien singulier de la divination. Disons que je joue aux devineresses.
- Madame, je ne comprends pas.
- Mademoiselle ! Je refuse les hommes, le mariage ! Je n’aime que les femmes, mais aussi les petites filles comme toi ! Est-ce que tu saisis ?
- Ysalis m’a dit ce matin qu’elle adorait prendre le sein d’une femme et…
- Sache, Odile, que tu n’es ici qu’une petite prostituée parmi quarante-et-une autres garces miniatures, et que tu dois satisfaire le chaland. Ici, c’est moi la cliente. Apprends que j’ai versé l’équivalent de deux cents dollars pour t’avoir pour moi seule, en exclusivité, cet après-midi. C’est le prix de la passe. Tu es une fille nouvelle ; Moesta et Errabunda équivaut à une sorte de maison de tolérance d’un genre nouveau, et mon amie Cléore incarne sa tenancière. Je suis claire, ce me semble, isn’t it ? Alors, comme toutes les filles de maisons closes, tu dois te soumettre à toutes mes petites envies, mes caprices d’anandryne déviante et mon questionnement en fait partie. Tu devras exécuter sans broncher tout ce que je t’ordonnerai, vu ?
- Qu’est-ce à dire ? riposta Odile, d’un ton épouvanté par les révélations de Jane.
- Petite cloche ! Fucking daughter of bitch ! You’re a bastard ! Ce sont les petites nouvelles comme toi qui m’attirent en général chez Cléore. A chaque livraison d’une pièce de biscuit, je veux être la première servie. J’exècre ce qui est surfait, usé, ébréché, trop vieux, démodé… Il me faut du neuf, toujours du neuf. Je ne suis pas américaine pour rien ! Cléore m’a renseignée sur toi ; j’ai accouru pour toi ! J’ai grand’soif de ta nouveauté.
- Et…euh…Qu’est ce que vous recherchez chez les fillettes ?
- Je veux connaître leur âge exact, déterminer l’instant où elles seront nubiles ! Le moment où le sang périodique cherra d’elles, of their stinking and sticky beaver ! Tu vas comprendre. »
Jane Noble se pencha sur la table où reposaient les deux sacoches. Elle ouvrit la première à sa gauche et en tira du linge passé, délavé et fané. Odile émit une grimace de dégoût en réalisant de quoi il s’agissait.
« Une jolie pièce de ma collection. Un bel échantillon, isn’t it ? Beaux pantaloons. Bien imbibés du premier sang de cette bécasse de Winifred Morstan, de Chattanooga, quinze ans, huit mois et dix-sept jours, lorsque, par défaut d’information, elle s’est laissée surprendre par la survenue de ce premier épanchement féminin le 24 juin 1883 à dix heures du matin, en pleine leçon de couture, ce qui a gâté ce beau dessous tout cotonné ! Les taches rouilles qui l’ont souillé et diapré en tout l’entrefesson sont explicites ! Et il fleure encore bon la fade odeur de cette hémorragie de la féminité. Cela a été mon premier trophée, que la pauvre pécore toute curly m’a vendu pour vingt-cinq cents, somme dérisoire ô combien, de peur que sa mère ne la grondât d’avoir abîmé sa lingerie par une indécence. »
Prise à son jeu fétichiste pervers, miss Noble se mit à coqueter tel un cocodès, n’ayant rien à envier au vilain rosalbin de Sarah. Elle extravaguait et effrayait Odile ; ses prunelles céruléennes étincelaient d’un feu extatique malséant. Elle exhiba cette lingerie, raidie par l’empois et par le sang séché de vierge, presque saponifiée par un vain lessivage, pourprée par cette humeur honteuse qui s’était extravasée sur l’étoffe blanche écrue, la métamorphosant en habit sacerdotal de la luxure, fourré d’aumusse écarlate et ocré à la fois par le vieillissement naturel du liquide rompu et coagulé. Ces pantalons de lingerie apparaissaient comme orfrazés d’un sang de la défloration, de la fornication d’une prostituée de l’Apocalypse. Devant ces orfrois sanguinolents qui avaient conservé jusqu’en leur trame textile élémentaire la fade fragrance des menstrues, un moine bourru paillard converti au satanisme eût entonné des orémus sacrilèges. Cette fille avait lâché son liquide comme on va à la selle, sans savoir, sans comprendre, comme d’autres avant et après elle, comme toutes les autres dont Jane Noble récoltait la souillure. Non encore satisfaite de sa démonstration, notre féministe choisit de poursuivre : un deuxième exemple fut exhumé de la sacoche.
Cela avait appartenu à une certaine Abigaïl Peacok, de Savannah, type même de la bonne grosse fille blonde, boudinée comme un boudin. C’était à croire que toutes ces graisses conséquentes, stockées dans tout ce corps de truie gravide, avaient hâté la survenue du cycle, à seulement quatorze ans, trois mois et vingt-quatre jours, le 18 novembre de l’an 1884. Jane Noble étala sans pruderie ce sous-vêtement d’une impressionnante largeur, dont l’entrecuisse, énorme, n’était plus qu’une macule pourprée, furfuracée de tachetures tournées au safran aigre avec le temps, linge irrécupérable épanché comme une fontaine de jus de groseilles écrasées, un malaxage de raisins rouges foulés dans une cuve par des vignerons ivres. La journaliste fit mine de plaquer ce cauchemar pachydermique contre la figure rétive d’Odile.
Bien qu’elle eût reculé, la fillette se sentit mollir comme une chiffe. Miss Noble en profita pour placer une troisième démonstration, qu’elle sortit cette fois de la sacoche numéro deux.
« Les bloomers de miss Kathleen de Maupertuis, de Fayetteville, réglée à seize ans, un mois et douze jours le 20 juillet 1886. Fort joli, n’est-ce pas ? »
Elle s’amusa à inhaler le parfum de la persistance odoriférante de ce premier sang, flairant sans retenue l’entrejambes et le fond sale de cette pièce de lingerie. Cette saleté avait appartenu à une jeune fille brune, presque aussi mince et grande que Jane, une jeune Sudiste aussi peu instruite de la vraie vie que les deux précédentes idiotes. L’étoffe bouffait, certes, mais le sang l’avait épaissie, amidonnée de sa forfaiture. Par le jeu de la coagulation, les taches s’étaient muées en agrégats squameux, en croûtes de vieilles blessures de guerre insanes, déshonorantes comme l’inceste, qui adhéraient encore au coton comme des arapèdes, du byssus de moule ou des anatifes à leur rocher. La fille avait tenté en vain de nettoyer le linge, de cacher l’offensive de la pourpre cardinalice. Ses efforts n’avaient abouti qu’à une usure vaine, à un délavage et un étiolement du reste de l’étoffe, où ces produits et vestiges de coagulation continuaient à pendre, comme s’ils eussent été sessiles, attachés à un pédoncule telle une parasitose mycologique. Malgré tout, elle avait voulu poursuivre contre vents et marées son lessivage intensif à en élimer ce linge jusqu’à la trame, sans que pour autant les traces de son forfait de jeune vierge disparussent. Elle avait repris, inlassable, son ouvrage, comme si c’eût été une marotte. L’odeur pestilentielle persistante de la chose l’incommodait, tant ces pantaloons de fille perdue du Vieux Sud puaient autant qu’un maroilles avarié de Thiérache. Ils avaient fini par ressembler à un Saint Suaire de l’abomination comme s’ils eussent daté de plusieurs siècles.
Jugeant que tout cela ne lui suffisait pas, miss Noble voulut accabler sa jeune proie d’un quatrième exercice spirituel de la surrection de la nubilité. Les quatrièmes pantaloons étaient écossais ; ils avaient été vendus à Jane par une certaine Lina Mc Laidlaw, d’Edimbourg, le 16 mai 1887, pour dix shillings, après que cette oiselle châtain-blond miel eut tenté de cacher l’événement à sa parenté qui se serait offusquée d’une telle incontinence. Ce linge avait appartenu à une vraie sauterelle ; on l’eût confondu avec celui d’une fillette de douze ans tant l’intéressée était conformée comme Cléore qui s’était pâmée à la vue de cette pourriture pour sylphide lorsque Jane la lui avait montrée. Or, Lina avait dix-sept ans, quatre mois et vingt jours lorsqu’elle avait été prise par surprise alors qu’elle montait son cheval en amazone lors d’une fox hunt. Empourprée par la honte, ses yeux noisette et verts effarouchés du fait de son désarroi, croyant s’être écorchée à la selle de sa pouliche, elle avait étanché sa perte rouge comme elle avait pu, à la mousse des chênes, et s’était contrainte à user du foulard de soie de son haut-de-forme comme d’une serviette, d’un chiffon provisoire. Sa minceur d’elfe avait retardé l’événement, mais Cléore l’avait battue, n’ayant été réglée qu’à dix-huit ans accomplis. Le fond de l’entrefesson des pantalons de miss Mc Laidlaw s’était moucheté d’un semis ridicule. L’étoffe de coton paraissait ornée d’un orpaillage de crottes. L’impétrante était réputée couiner lorsque son indisposition survenait.
« Tu comprends l’utilité d’une telle collection ? poursuivit Jane. Elle permet de constituer des séries statistiques, des barèmes, des moyennes. On peut connaître l’âge moyen des premières pertes chez nos contemporaines. La science divinatoire que je pratique en outre, et à laquelle je m’apprête à te soumettre – non, ne bronche pas – a pour but de déterminer à quel moment toi et tes amies de Moesta et Errabunda parviendrez à la nubilité.
- Vous êtes odieuse !
- I’m sorry, mais il va falloir te laisser examiner par moi.
- Je refuse !
- Sois courageuse, petite. Cela ne sera rien. Sache que j’ai failli, l’an passé, me faire amputer de mes seins parce que je considérais ces attributs de la féminité comme gênants et inutiles.
- Que voulez-vous que cela me fasse ?
- J’en avais assez de ces symboles d’esclavage de la femme, mais, à la parfin, je jugeai qu’il valait mieux que je les conservasse, non pas au nom de considérations esthétiques, je m’en fiche, mais parce qu’un médecin m’avait instruite des risques de complication encourus en cas d’ablation et de mutilation radicales. »
Odile poussa un nouveau questionnement, comme un cri de détresse tentant de repousser l’inéluctable :
« Et si j’essaie de résister…en vous frappant et vous griffant, par exemple ?
- Tu y tiens absolument ? jacta Jane, haineuse. Hé bien, écoute-moi et regarde ! »
Elle tira de la seconde sacoche d’autres pantalons de broderie dont le sang, c’était incontestable, paraissait encore tout frais, comme fluidifié par une lamie obscène.
« A cause de ton obstination, stupid shabby pussy, je vais sacrifier devant toi ma dernière acquisition, que j’ai achetée ce midi même à la fille d’un édile, Mademoiselle Pierrette R**, pour vingt-cinq francs ! Ils exhalent encore l’émollient effluve des pertes fraîches. What a pity ! Tu vois cet aquarium, là-bas, vers le fond ? Il contient des poissons carnivores redoutables, qui aiment à se repaître de toute chair écorchée dégouttant son sang frais. Non, ne joue pas les peeping Tom. Contente-toi de regarder sans broncher en sachant que, si tu désobéis, c’est toi que j’offrirai en pâture à ces piranhas et ces murènes, comme je l’eusse fait d’un esclave désobéissant si j’avais été une patricienne romaine. »
Jane Noble s’approcha de la cage de verre où, dans une eau tropicale chauffée discrètement, d’hideux vertébrés pisciformes armés de mâchoires agressives nageaient. On se demandait comment deux espèces aussi incompatibles, issues de deux milieux aussi différents, salé et doux, faisaient pour survivre dans ce liquide saumâtre où croupissait du cresson grouillant de paramécies et d’autres infusoires. Perversité de Cléore : il n’y avait aucun couvercle de sécurité. Avec une facilité déconcertante, la féministe dérangée put donc jeter dans cette cage aqueuse cette lingerie festonnée où des gouttelettes vermeilles perlaient encore, comme si les entrailles de celle qui avait dégorgé ce sang encore anormalement tiède vu qu’il remontait à un peu plus de quatre heures eussent été frappées d’hémophilie. Cela avait dû ressembler à une fuite conséquente de plomberie, à des coulées d’hémorroïsse biblique néotestamentaire, quoique des hécatonchires mythiques atteints de coliques souffrissent des mêmes épanchements spectaculaires. Jane avait surpris la jeune impétrante de quinze ans dans les toilettes communes de l’hôtel, alors qu’elle se vidait sans même avoir eu le temps de pousser le verrou, affolée par sa perte écarlate, et le seul moyen qu’elle eût trouvé de cacher cela à ses parents, selon le classique principe du motus et bouche cousue avait été de se déculotter devant Jane et de lui vendre sur-le-champ son infâme dessous pourri comme prix de son silence.
Dès que l’étoffe blette et chancie par cette hémorragie eut chu dans l’eau, piranhas et murènes se précipitèrent afin de faire bombance. Les dents de ces petits monstres écailleux déchiquetèrent ces pantaloons avec une extase de gourmets pansus à en craquer. Ils taillèrent en pièces cette lingerie surie, qui répandait une effluence aigre, l’effiloquèrent à tout-va comme on dépèce le cadavre d’une créature gâtée par une maladie de l’amour. Le ballet des prédateurs autour du linge rougi qu’ils réduisaient à néant, engendrait un remuement, une agitation tourbillonnante et trouble d’eau sale. Une pluie squameuse d’étoffe, de fibres de coton, de fragments de chair textile, de lambeaux épidermiques tachés d’un sang de fils histologiques rompus en myriades de croûtes de tissu infinitésimales, tels des brins minuscules de charpie morte, retomba jusqu’à la vase synthétique qui tapissait le fond de l’aquarium, en s’amoncelant comme une sédimentation tégumentaire dissoute par un vitriol gastrique.
« Alors, te voilà convaincue ? Je te pense mûre pour mes petits examens. » riota Jane Noble.
C’en était reparti pour une nouvelle séance de maquignonnage. Jane ordonna à Odile de se jucher sur un escabeau et d’y demeurer, debout. Ainsi, lorsque des yeux paillards se levaient et regardaient sous ses jupes, ils apercevaient le fond des bloomers satinés et ouatés de la petite fille. Miss Noble prit le temps d’allumer un nouveau cigare, un Trichinopoly, d’en tirer quelques bouffées, d’épandre sur son cou pâle l’efflorescence musquée d’une fiole de civette, avant de prendre dans son réticule une loupe d’horloger et de débuter l’examen de la pièce de biscuit dressée sur l’escabelle. Dans cette position inconfortable, il n’était point temps pour la fausse Cléophée de faire des manières de princesse effarouchée, de s’abriter derrière la blésité verbale comme l’eussent tenté les autres pensionnaires. Elle n’y songea pas un instant, rentrant ses griffes, réservant leur usage dans l’expectative de la brutalité.
Sans crier gare, en un geste presque leste, Jane releva la robe et le jupon d’Odile et plaqua son nez et son œil droit, pourvu de la loupe d’horloger, contre l’entrecuisse de ses pantalons courts d’été. Ses mains s’empressèrent de déboutonner la fameuse ouverture médiane et d’en écarter l’étoffe. Puis, sans ménagement, l’orifice nasal de la journaliste se fourra contre l’intimité de la fillette qui en frémit d’horreur. S’arcboutant aux barreaux de la petite échelle comme un mousse aux agrès, Odile essaya de faire abstraction des manipulations scandaleuses de cette dépravée. Les narines de cette folle obsédée humaient avec délice les effluves corporels ammoniaqués en murmurant en anglais : « What a dirty pussy cat ! ». Tandis qu’elle se laissait odieusement flairer, Odile-Cléophée souhaita que tous les démons des enfers emportassent et patafiolassent la maudite journaliste.
Jane alternait les coups de loupe et les humections nasales. Elle reniflait, inspirait, absorbait les senteurs sauvages et brutes de l’enfant avant d’expirer son souffle ardent sur la chair secrète dévoilée non encore pubescente. Elle connaissait le pouvoir aphrodisiaque des fragrances intimes des femmes et des fillettes. Elle s’en pâmait, s’en régalait. Elle perçut un détail révélateur et jeta à Odile :
« Tu as frôlé la défloration ! Je ne salue pas ton parâtre. »
Elle poursuivait son manège érotique, fascinée visuellement et olfactivement par cette immature amande vierge offerte comme un calice d’ambroisie, attirée irrémissiblement telles les truites par le frai. C’était horrible, indicible, innommable. Odile savait malgré elle que des femmes déviantes, atteintes de délire obsessionnel, étaient capables d’user de leur bouche et de leur langue là où il ne fallait pas. Mais leur nez ! C’était nouveau ! A ce jeu, il était inévitable que les fines parois de la fleur d’hyménée se brisassent ; le viol fut lors entier. L’enfant poussa un couinement. Jane Noble, se retirant enfin, prise par son jeu, s’exclama avec la solennité d’un prophète orgiaque :
« Je sais quand tu seras nubile, ma chérie ! L’événement aura lieu à quinze ans, cinq mois et vingt-six jours ! Mon exercice de divination est terminé. Ce que je te dis est fiable. Jamais je ne me suis trompée. Je pratique une science exacte ! »
Une fois la douleur de l’abus passée, la tension d’Odile retomba. Elle ne serait plus jamais la même. Elle voulut laver sa souillure, comme le fit Délia.
« Garde ton impureté en toi ! lui recommanda Jane Noble. Inutile de te débarbouiller là où je pense. Cette tache doit demeurer en ton moi intime jusqu’à la fin de tes jours ! J’ai ouvert la porte ! Si tu veux obturer cette ouverture de la honte, fais comme Adelia. Insère-y un beau bijou hyalin. Comme cela, ton emposieu ne déversera plus son hémoglobine sur moi. Tu m’as tachée de ton sang de rupture, espèce de petite marie-salope ! »
Le beau visage de notre Américaine se trouvait empouacré par la macule grenadine essentielle de la déchirure et du dévergondage. Elle exhalait une odeur fade et âcre, aussi hideuse que celle du coagulum. Même son corsage était gâté par un ténu semis de gouttelettes rouges. Elle essuya ce gâchis avec un mouchoir de soie nattier qu’elle jeta à terre avec dédain. Puis, prise d’une soudaine faiblesse, elle devint suppliante. La tête lui tournait ; elle s’affalait ; ce n’était point l’ivresse de l’extase mais bien le manque de cocaïne qui l’amollissait ainsi. Elle mendia à la fillette qu’elle venait d’odieusement déflorer l’ouverture d’un petit étui de calicot, qu’elle avait pendu à sa jupe comme une aumônière ou une breloque. Les mains lui tremblaient tant qu’elle ne pouvait manipuler aucun des ustensiles qu’Odile en extirpa. Or, s’inoculer cette fameuse solution à sept pour cent la pressait, et elle avait grand mal. Son regard s’embrumait ; elle risquait la syncope. Avisant une courroie de cuir, la fillette demanda :
« Dois-je vous faire un garrot au bras ?
- Non…inutile…marmonna la journaliste. Nous n’avons plus le temps. Tu vois cette fiole ? Tu en casses le bout, là, doucement, et tu y mets la seringue de Pravaz… Tu presses le petit piston, là et elle se remplit. Alors, pique-moi, pique-moi directement au cou…oui… à cet emplacement que je te désigne… Cela passera plus vite, circulera dans le sang promptement. »
L’enfant, malgré toutes ses humiliations, renonça à mal faire, à profiter de l’accès de faiblesse temporaire de Jane pour exercer une vengeance à chaud. Elle suivit scrupuleusement les directives de la droguée. Lorsque notre féministe folle marqua son soulagement en multipliant les soupirs d’aise, la fillette souillée se décida enfin à la contre-attaquer. Odile déstabilisa Jane en déclarant :
« Et Délie…l’avez-vous « inspectée » comme moi ? »
Désorientée, piégée, miss Noble ne put que répliquer en balbutiant :
« Dé…Délia ? Elle est perdue et elle l’ignore. Je…je l’ai vue en effet. Ses épanchements périodiques sont imminents…Dans…trois mois tout au plus. C’est…fort tôt, isn’t it ?»
Alors, Odile lui lança :
« Vous êtes un monstre, madame ! »
Refuser à Jane son identité de demoiselle saphique était selon elle l’injure suprême. Perdant tout contrôle, elle se précipita sur la soi-disant Cléophée et voulut la gifler. Mais Odile la griffa à la joue gauche. Cette estafilade, de laquelle perlèrent quelques gouttes sanglantes, abîmait à peine la vénusté de la féministe, à moins que ces deux salissures sanguines consécutives ne dévaluassent son image irréprochable auprès du club très fermé des Bostoniennes. Lors, à fins de vengeance, comme si elle avait jà oublié ce que la petite fille venait de faire pour elle, ingrate et rancunière comme toutes les perverses égocentriques, Jane bascula dans la cruauté ; elle déculotta Odile, lui arrachant son dessous, ces bloomers que les filles pauvres ne méritaient pas d’arborer. Elle mordit la fillette jusqu’à l’hémorragie. Un cri insoutenable secoua les aîtres qui s’imprégnèrent de cette souffrance à la manière d’une émulsion photographique. Laissant sa victime pleurer et geindre dans sa douleur intolérable, quasi nue et humiliée, Jane déverrouilla la porte et sortit de la bibliothèque sans demander son reste. Elle en avait eu pour son argent avec la jeune rebelle. Elle ferait sa réputation dans le milieu des anandrynes. Désormais, elle haïssait les brunes aux yeux d’acier bleu semblables à elle, cette Odile qu’elle avait crue jumelle…
![]() |
| Wound |
*****************
Cet après-midi là était pour Adelia le plus important de la semaine : c’était le jour de la visite du bourreau de Béthune, le client masculin d’exception, comme l’on sait. L’homme se rendait en la fameuse salle de géhenne, jà montrée tantôt, revêtu de pied en cap de sa panoplie de maître tourmenteur médiéval. C’était là ce qu’on eût tenté de faire accroire, mais, dans la perversité et le fantasme de ce client, les rôles, en fait, s’inversaient. La place était encore chaude, à peine libérée par ces saletés de jumelles et leur comtesse vampirisée et consentante. Délie s’était adonisée avec un soin extrême, n’ayant omis aucun padou à son coiffage et à sa robe, ayant multiplié à son gré, à sa fantaisie, les rubans fuchsia, lilas ou pourprés. Sa peau exhalait une émolliente senteur de bergamote, de styrax et de jasmin. Elle avait imprégné sa vêture et sa lingerie d’eau de mélilot, de macis et d’essence de lavandin. Elle s’était maquillée, avait ourlé ses lèvres d’un rouge d’Espagne violent et charbonné ses yeux éméraldiens. Ses ongles, manucurés jusqu’aux lunules, étaient vernis d’un rose éruptif qui débordait sur ses phalangettes. Elle croisa l’affreux faudesteuil tavelé par le rut de celles qui l’avaient précédée et jeta un peuh de mépris à l’encontre de Daphné et Phoebé.
Le bourreau de Béthune arborait une cagoule de cuir pourpre, dotée de deux ouvertures orbitales et d’une fente nasale, mais l’emplacement de la bouche demeurait clos, obturé. Par ailleurs, afin qu’il accentuât son tourment, il operculait toujours cette bouche avec un sparadrap. Conséquemment, il ne pouvait parler. Cela lui conférait un mutisme inquiétant et il ne pouvait marmotter que des mmm…mmm… ou des hu…hu… d’idiots congénitaux déshérités de cirque que Délia se devait de décrypter si elle voulait que s’exécutassent correctement les souhaits morbides de ce client illustre quoiqu’il vînt incognito.
Sous l’anonymat de la cagoule de cuir, le bourreau de Béthune n’empêchait aucunement les spéculations de courir au sujet de son identité. D’aucuns prétendaient qu’il s’agissait d’un ministre important, celui de l’Intérieur sans doute. Il dissimulait ainsi ses vices et affichait en public une vertu de façade fort commode, lui qui luttait officiellement contre la prostitution et appuyait l’action de la Mondaine ou de ce qu’il en restait depuis 1881. D’autres pensaient que c’était un important industriel, membre du Comité des Forges, mais la thèse du ministre de la police semblait la plus probable : la ventripotence du client correspondait de manière troublante avec celle de Monsieur V**.
Il ne portait point de chemise. Son torse ventru et épilé se ceignait d’un cilice et afin que ses atours imitassent avec le plus d’exactitude possible la panoplie supposée de Monsieur de Béthune (ainsi qu’on le qualifiait respectueusement en ce temps de barbarie, comme l’on disait Monsieur de Paris ou Monsieur de Lyon), l’anonyme sadique avait endossé des hauts-de-chausses bouffants à crevés, d’une coupe Henri II, à moins qu’elle fût espagnole, où alternaient le vieux cuir tanné et la basane. Sa poitrine était presque féminine et répugnait. Mais, ce qui émoustillait le plus les sens d’Adelia, c’était la braguette du client. Elle était proprement énorme, spectaculaire, disproportionnée, tels ces cache-sexe de sauvages des antipodes qui exposent plus qu’ils ne dissimulent. Elle se conformait authentiquement à la mode du XVIe siècle, à ces portraits fameux en pieds de Charles Quint, Henri le deuxième ou Henry VIII Tudor. C’était une véritable boîte de Pandore rabelaisienne. Cette coquette atrocité était damassée, modelée, cousue, taillée aussi dans le velours et le brocart, à trois fasces de gueules aux armes de l’inconnu, alternant sable, sinople et vermeil conformément à une lecture hétérodoxe des lois de l’héraldique. Délie fantasmait devant ce symbole masculin. Las, elle savait que Cléore prohibait ce type de fantasme et elle s’en désolait beaucoup. Il fallait donc que ses divagations de petite friponne se tournassent vers d’autres choses. Plus sadique que jamais, elle se voyait lors serrant dans un étau les membres du bourreau de Béthune, de préférence dans des brodequins inquisitoriaux, afin qu’ils fussent broyés, éclatassent, partissent en bouillie immonde, en charpie sanglante, tels ces insectes bicolores, noirs et rouges, que l’on surnomme les diables. Munie d’une loupe, Adelia, en ses petits jeux, s’amusait souventefois dans les pelouses abandonnées du domaine, à dénicher ces bestioles puis à les brûler comme avec un miroir d’Archimède. Le feu prenait rapidement. La chitine roussissait et tandis qu’elle devenait bientôt noire et qu’une douce fumée s’élevait, les insectes mouraient en expulsant leur chair interne, toute blanchâtre et infecte, pulpe molle qui promptement se carbonisait.
Délia put constater de visu la laxité des chairs flasques du bourreau de Béthune. L’homme était inerme : c’était elle, qui, dans ce jeu cruel, devait s’armer. L’homme émit un gargouillis, un grrlll de malade souffrant d’un squirre du larynx. Cela signifiait : « Déshabillez-vous, mon enfant »
C’était à croire qu’Adelia, dans cette pièce dont nous rappelons la température conséquente, n’attendait que cet ordre préliminaire. Elle s’exécuta avec une hâte farouche, provoqua la chute de son corsage, de sa jupe et de son jupon de percaline. Elle dévoila ainsi son fameux corset de cuir, dont elle avait encore resserré le laçage par rapport au matin. Délia arborait lors une taille de guêpe optimale qui l’étranglait, la suffoquait. Elle avait poussé la fantaisie érotique jusqu’à changer de dessous, enfilant des pantalons de deux tailles inférieures à la sienne. Cela la moulait conséquemment, engendrait en son corps de sylphe innervé des courbes qu’elle n’avait point encore. Sa cage de cuir la compressait tant qu’elle en lésait presque ses viscères et appuyait sur ses ovaires en voie de maturation, lui occasionnant des brûlures de fer rouge et de délicieux tourments. Même ses jarretières s’avéraient sciemment par trop serrées ; elles galbaient ses jambes juvéniles exagérément gainées dans de suggestifs bas noirs.
Les narines du bourreau de Béthune s’agitèrent, perturbées par les effluences excitantes de ces dessous de poupée, tandis que ses yeux, extasiés par les courbes menues engoncées dans un linge de coton prêt à craquer aux coutures, roulaient dans ses orbites. Les mmmg mmmg répétitifs de satyre échauffé qu’il ne cessait de jeter achevèrent de convaincre la fillette perverse qu’elle tenait solidement cette proie dans ses rets. Elle minaudait, lissait les bouclettes de ses cheveux brun-roux, se mettait sur la pointe de ses bottillons vernis, bombait sa petite gorge et ses petites fesses qui menaçaient de déchirer le fond de ses pantalons de broderie, se déhanchait avec une exagération de coquelet à la parade. Notre jeune Salomé délurée arquait son buste inconsidérément, de manière à ce que ses seins naissants pointassent et allumassent en sa victime des feux inextinguibles de lubricité. Elle faisait mine de quémander un câlin, une caresse osée de ses parties charnues, puis reculait à l’ultime seconde, hors de portée des mains entreprenantes du client, se ravisait en lui tirant la langue. Se sachant désirable, la petite catin en rajoutait d’autant plus que la touffeur des aîtres provoquait en elle une montée de sève sadique. D’habitude, elle allait moins loin, se contentant de quelques câlineries anodines avant d’assener de mollassons cinglements de fouets à ce vieux sadique obèse qui s’en satisfaisait amplement. Mais, ce jour là, peut-être mise en train par la séance de correction de Jeanne-Ysoline, Délie s’était décidée à sortir le grand jeu de la séduction, à en mettre plein la vue.
De plus, ses sudations – son visage, ses joues, ses bras s’humidifiaient et rougissaient à vue d’œil – exulcéraient sa peau fine. Son épiderme érubescent et dégoulinant de fluide corporel sudorifique semblait s’enflammer d’éruptions cutanées érysipélateuses. Son aine et ses aisselles ruisselaient d’un suint ranci résultant de la blettissure des parfums épidermiques dont elle s’était enduite. Incommodée par ses coulures séreuses, par cette diaphorèse, il fallait qu’elle prît garde de ne point s’anonchalir jusqu’à en devenir alanguie. Elle manqua succomber à un accès de morbidesse. Pour s’éventer, elle entrouvrit exprès son fameux bouton de l’entrecuisse jà trempé et s’assit sur un tabouret, jambes écartées, en face du bourreau. L’homme entrevit le cabochon indien indicible et en trembla de désir. Il entr’aperçut la fameuse nouveauté printanière d’un tatouage multicolore et artistique sur lequel nous reviendrons, image de peau qui ajoutait une touche d’érotisme supplémentaire à ce corps désirable. Les pantalons de Délie étaient si mouillés et oppressants qu’ils paraissaient bons à essorer. Ils en devenaient quasiment transparents, moulant en son postérieur gracieux des rainures aqueuses d’une impubère impudicité. Changeant de position, Délie se retourna sur le tabouret et s’y agenouilla, son dos et son fondement dans l’axe de vision du bourreau de Béthune. Se retenant cependant de lâcher un vent d’insulte, Adelia effectua quelques mouvements, bombements et balancements évocateurs, comme si elle eût chevauché et cravaché un poney. Pouvant à peine bouger, à la limite de la déchirure de ses pantaloons, elle se releva ensuite et s’approcha du client désormais bien entrepris. La main du pervers essaya de se poser entre ses jambes, de tâter son joyau intime, de le porter à ses lèvres de fol ; elle esquiva le coup d’extrême justesse et, avec sa brutalité accoutumée, arracha d’un seul geste le cilice du gros dépravé. Le mmmmrrr qui surgit de la cagoule rouge fut si puissant qu’on l’eût pris pour le grondement d’un éléphant de mer lors de la saison des amours. Délia crut lors à un paroxysme viril. Elle attacha donc sa consentante victime, dos face à elle, contre un des murs lépreux et verdâtre parsemé de bulles de lichen et salpêtré à profusion. Deux anneaux de fer rouillés se refermèrent sur les poignets du bourreau de Béthune. Elle choisit enfin la schlague appropriée à sa tâche, un modèle de fouet à quatre lanières teintes dans un vert cadavérique propre à effaroucher les imbéciles et les jars blancs.
L’homme n’était que plaies purulentes, mal cicatrisées. Cela rappelait à Délie une vieille légende d’Alsace, où il était question de momies vivantes d’hommes-singes, d’hommes-ours ou d’hommes-pourceaux, confites dans des bandages pourris exhalant des miasmes mortifères, pansements chancis et blets, suris d’ichor et de sanies, sur lesquels venaient bourdonner et grouiller des mouches agressives. On appelait ces créatures misérables, à la frontière de la bestialité, Schmüwgs, Schützes ou Schmützes, à moins que cela fût Schmülls ou bien Schmölls. Elle ne savait plus, et peu lui importait. Ces hommes-bêtes étaient voués aux coups répétés, aux meurtrissures, comme autant d’images de la Passion. Ils portaient en eux tous les péchés du Monde. Ils étaient nés pour la souffrance et, à moins qu’ils se corrompissent d’une oxydation naturelle post-mortem, on les avait destinés à pourrir vifs de l’infestation de leurs plaies.
Devenu presque dolent, le bourreau de Béthune n’attendait plus que le fouet. Il paraissait appliquer en lui la devise des jésuites : perinde ac cadaver. Suffoquée par son corset de guêpe, incommodée qui plus était par les relents musqués des chairs gangrenées et purulentes du client, mais s’échinant malgré tout à le satisfaire, Délie, afin de ne pas fléchir, de ne point s’évanouir au spectacle de ces masses carnées noircies et zébrées en profondeur par les précédentes séances de supplice, répandit une poudre de riz à la fragrance d’héliotrope sur sa figure et ses cheveux auburn immergés dans ses propres suées malodorantes. L’homme, pitoyable, jeta alors un mmmmggg…mmmgg… ou un aôoog… de Schmütz à la semblance d’un râle, murmure qui signifiait soit « Bourreau, fais ton office », soit « Je t’adjure mon enfant de bien me frapper. » Les lanières d’Adelia s’en donnèrent lors à cœur joie sur cette purulence indicible qui dégouttait de coulures jaunâtres et noirâtres tel un bitume, cette putrescence dorsale qui ne cicatrisait plus. Le sifflement des lanières, le bruit des coups résonnant dans la sinistre pièce voussée et close perturbaient l’ouïe de la jeune sadique au point d’en abolir son entendement et sa conscience. C’était comme un tintement continu de crécelles auxquelles se fût superposé le gong assourdissant d’un faux-bourdon de cathédrale. De nouvelles entailles pesteuses s’ajoutèrent aux crevasses précédentes et aux excoriations multiples tandis que le souffle oppressé du tourmenté obèse exhalait des exsufflations répétées d’asthmatique ; et Délia poursuivit jusqu’à ce que cette masse mâle déchue tombât, comme succombée sous sa maltraitance.
A l’ombre des braseros qui crépitaient, dans la lueur rougie et ténébriste de la salle de torture, elle daigna se pencher sur l’homme, pour vérifier s’il respirait encore. Elle redoutait un trépas qui eût débouché sur une affaire d’Etat, comme si elle eût su qui se dissimulait sous la cagoule de cuir rouge. En fait, son excitation était à son comble. Elle eut la tentation de vérifier si le membre du bourreau s’était enfin dressé durant l’administration de cette flagellation. Elle avait jà dégusté la liqueur masculine dans un calice aux armes du démon lors d’une messe noire célébrée par la Mère trois mois auparavant, cérémonie odieuse où les officiantes hérésiarques – Cléore et de nombreuses tribades - avaient consommé une hostie sacrilège de suie, marinée, disait-on, dans de la graisse d’avorton humain. Toutes avaient extravagué, prises de transes hystériques telles les possédées de Loudun, et n’avaient cessé leurs trémoussements qu’après qu’elles eurent été fourbues. Sans se faire prier, la jeune fille avait absorbé ce verjus de gélatine cauchemardesque, bien que son estomac délicat fût pris de crampes et de secousses spasmodiques à l’absorption de cette immondice. Elle l’avait coupée d’un vin de messe si vieux, si passé, si suri, qu’il n’était plus qu’un vinaigre pelliculé d’une moisissure d’oïdium d’une acidité telle que l’enfantine catin, ses accès nauséeux devenus irrémissibles, avait inondé sa robe de petite fille modèle de vomissures pestilentielles, se jurant dès lors qu’elle ne boirait jamais plus de telles horreurs, s’imposant l’abstème à vie. C’était un alcool mâle fort, bouillant, un cru vinicole de la véraison, un substrat épais, plein d’un dépôt indéfinissable, dans lequel s’agglutinaient et agonisaient des millions d’homoncules vibrionnants et frénétiques voués à leur perte. Elle avait bu malgré tout cette saleté comme une huile de foie de morue soignant les poitrinaires, pensant gober toute une frayère de crapauds répugnants, toute une ponte gélatineuse d’amphibiens pustuleux. Cléore s’enquit de son mal-en-point lorsqu’elle vit sa robe perdue et que ses narines perçurent sa malodorance.
« Qu’avez-vous donc, ma mie ? »
Délia, qui avait voulu faire bonne figure dans cette cérémonie imposée par la Mère et partager les agapes de ces hérétiques, avait répondu :
« Rien…je ne suis pas habituée à ce type de boisson, un point c’est tout », avant de s’effondrer comme une poupée de chiffon dans les bras de son adorée sous les cris de désarroi des autres tribades enivrées de leur stupre.
Balayant ce souvenir douloureux, Adelia hésita devant la braguette. Elle se demanda si elle n’observait pas un leurre, un faux-semblant, dissimulant peut-être une castration, une émasculation volontaire du bourreau de Béthune, ce qui eût expliqué son apparente impuissance. Elle voulut ôter l’objet afin d’en avoir le cœur net. Puis, elle se morigéna, se rengorgea :
« Non, songea-t-elle, Cléore le saurait et elle chargerait Sarah d’exécuter la sentence punitive. »
Elle haïssait la vieille juive par-dessus tout, tremblant à l’idée que ses mains noueuses pussent la fustiger et la meurtrir. Gâcher sa beauté d’Irlandaise aux yeux verts eût représenté le comble du châtiment.
Délia constata enfin que l’homme respirait encore, bien qu’elle eût cru à une syncope fatale, du fait que le contrevenant arborait un cœur graisseux propre à l’embolie. Alors, une crise d’épilepsie la frappa sans prévenir. Elle bava, se roula par terre, tenta de se blesser contre les meubles et les objets de torture. C’était comme si la déraison eût triomphé en son cerveau. Cette crise de démence se prolongea longtemps, entrecoupée de phases d’atonie. Délia risquait d’en avaler sa langue, de la couper net. Elle n’eût pas survécu à cette automutilation. Réalisant sa folie pure, elle mordit le manche de sa schlague, serra si fortement celui-ci dans sa mâchoire d’enfant méchante que ses dents en furent ébranlées. Enfin, elle se calma. Sa quiétude recouvrée, elle s’accroupit et, profitant de l’ouverture de ses pantalons trempés et désormais puants, se soulagea sans façon comme un animal sauvage marquant son territoire.


















.jpg)



































.jpg)